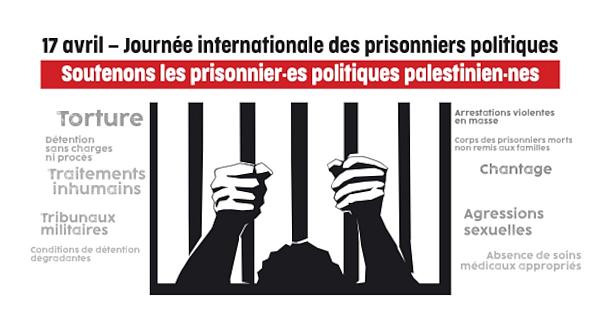Nadège Magnon, AFPS - PalSol n°74
Cette victoire n’était pas encore tout à fait définitive car la France disposait d’un délai de trois mois, à compter de la date de la décision, pour faire un recours devant la grande chambre de la CEDH. Malgré la demande insistante en faveur de la saisine de cette chambre par des organisations pro israéliennes et notamment du CRIF qui a adressé des lettres, rendues publiques, au Ministre des affaires étrangères et à la garde des Sceaux de l’époque, le gouvernement français a renoncé à ce recours.
Il faut dire que cet arrêt très argumenté et rendu à l’unanimité des sept juges, dont le juge français, concernant le point sur la liberté d’expression rendait peu probable une position différente de la grande chambre de la CEDH compte tenu de sa jurisprudence en la matière.
Désormais cet arrêt est définitif. Les décisions de la CEDH sont supranationales, elles s’imposent dans les États qui ont signé la Convention européenne des droits de l’Homme, dont la France. Cette décision rend obsolètes, de fait, les circulaires Alliot-Marie et Mercier de 2010 et 2012. Elle rend également non pertinente toute référence aux arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2015, notamment de la part de ceux qui prétendaient que l’appel au boycott était interdit en France.
Une décision à populariser
Nous ne pouvons compter ni sur l’État français condamné, ni sur les partisans d’interdire toute critique de la politique d’Israël pour la faire connaître. Ne nous privons pas d’apporter la plus large publicité à cette décision qui non seulement confirme la légalité de ce moyen d’expression mais rejette également l’amalgame entre l’appel au boycott d’Israël et l’antisémitisme. Après avoir relevé qu’aucun des requérants n’avait été condamné pour avoir proféré des propos racistes ou antisémites, la CEDH a ainsi souligné : « En effet, d’une part, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale. D’autre part, ces actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante… »
Cette décision mérite d’être martelée auprès des pouvoirs publics, des parlementaires, des collectivités territoriales, des entreprises, des médias pour faire cesser cette rengaine d’une prétendue interdiction de l’appel au boycott. Elle devrait nous aider également à populariser auprès d’un large public la campagne BDS et les inviter à y participer « en toute légalité ».
Les limitations de la liberté d’expression
Il convient cependant de rappeler que si la CEDH a affirmé l’existence d’un droit à l’appel au boycott, l’arrêt fixe clairement les limites à ne pas dépasser. Les discours de haine, d’intolérance et d’appel à la violence ne sauraient être tolérés et heureusement car nous les condamnons également.
Cet arrêt ne prive pas d’effet la loi française de 1881 concernant la diffamation et l’injure. Une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne reste passible de sanctions au regard du droit français comme du droit européen. Les écrits, les paroles publiques doivent rester mesurés, prudents, vérifiés et sans exagération. Ceci a d’ailleurs toujours été et doit demeurer notre ligne de conduite.
Cet arrêt statue sur un moyen d’expression, l’appel au boycott, mais n’autorise pas pour autant tout type d’action au nom de cet appel. Les actions portant atteinte à la propriété privée, à la liberté du commerce notamment restent prohibées par la loi [1]. Cela rejoint nos préconisations pour nos actions concernant le boycott.
Mais les limitations doivent être justifiées
La liberté d’expression est un droit fondamental qui peut être restreint mais à la double condition que l’entrave soit prévue par la loi et motivée par un but légitime nécessaire dans une société démocratique.
Cet équilibre se pose notamment lorsque le trouble à l’ordre public est invoqué pour restreindre la liberté d’expression, par exemple en matière de distribution de tracts sur la voie publique ou de liberté de réunion. Certains pouvoirs publics, certains maires pourraient être tentés de s’appuyer non plus sur une prétendue illégalité des appels au boycott mais sur un prétendu risque de trouble à l’ordre public pour entraver des actions devant les supermarchés, des distributions sur la voie publique ou encore pour interdire des réunions.
Ce prétendu trouble à l’ordre public ne peut pas être une justification en lui-même. Il doit être justifié et démontré par celui qui l’invoque pour restreindre voire entraver la liberté d’expression. À défaut d’une telle démonstration, un recours en justice pourrait alors être envisagé en s’appuyant sur l’arrêt de la CEDH du 11 juin 2020. Espérons que les pouvoirs publics seront assez sages pour ne pas nous y contraindre !