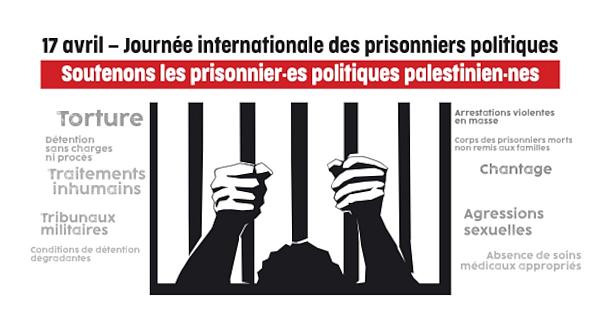1.La déstructuration du droit contenu dans la Charte des Nations Unies
Le droit international a pour fonction la régulation des rapports entre les sujets de droit ; à ce titre, il n’est pas destiné à planer au-dessus des réalités. En effet, il est le fruit de contradictions d’intérêts qu’il tente de traduire et de matérialiser dans des normes afin de les surmonter ou de les dépasser. Force est de constater que la nature de la mutation de ce droit dépend de la nature même des contradictions.
Ces dernières années, elles se sont approfondies et parfois même exacerbées devant la violence déchaînée, souvent sans limites, des puissants. Ainsi le droit international en vigueur s’est trouvé dépassé par les faits, sans pour autant tomber en désuétude.
La Cour Internationale de Justice ne vient- elle pas, en juillet 2004, de rappeler - dans son avis consultatif portant sur la construction du mur- l’obligation de tous les Membres de l’ONU de s’abstenir dans leur relations internationales de recourir à la force ? N’ a t elle pas rappelé le principe de l’autodétermination des peuples en particulier la disposition de l’article 1er commun aux pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques ?
L’Assemblée générale de l’ONU continue, de son côté, à proclamer la nécessité du respect des principes et des règles de la Charte ; en particulier, l’obligation de respecter l’égalité souveraine de tous les États et de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou d’agir de toute autre manière qui serait incompatible avec les buts des Nations Unies. Elle a aussi rappelé que tous les peuples aspirent à un ordre international fondé sur les principes consacrés dans la Charte et, notamment, sur la nécessité de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous et d’en encourager le respect, ainsi que celui des principes relatifs à l’égalité des droits et à l’autodétermination des peuples, mais aussi de promouvoir la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, la primauté du droit, le pluralisme, le développement, l’instauration de meilleures conditions de vie et la solidarité [1].
Dès lors, pourquoi les puissants font ils fi de l’interdiction de l’utilisation de la force (article 2 § 4 de la Charte de l’ONU), de l’autodétermination des peuples, de l’obligation de régler pacifiquement les différends, accompagnée d’une tentative doctrinale tendant à assouplir considérablement la portée desdites obligations, notamment par le bais de l’intervention dite humanitaire ?
Nous assistons, depuis quelques temps, à la déstructuration du droit international » classique » et « dur » fondé sur la Charte, un droit essentiellement politique. Ce droit est l’objet d’une neutralisation de la part des Etats-Unis et de leurs alliés (Japon, Etats européens) particulièrement en ce qui concerne la coopération internationale, le règlement pacifique des différends et la paix et la sécurité internationales ou si l‘on veut, le droit à la paix.
En effet, là où le processus de déstructuration de l’ordre juridique international a été le plus frappant politiquement concerne l’érosion du système de sécurité collective, notamment par les tentatives d’abolition unilatérale de facto de l’interdiction générale du recours à la force consacrée par l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, universellement reconnue comme étant une norme impérative du droit international contemporain. Les violations successives de la part des Etats-Unis et leurs alliés de l’interdiction du recours à la force remettent en cause non seulement une norme impérative du droit international, mais encore, ont pour conséquence directe d’ébranler tout le système de sécurité collective. Un autre coup dur porté au droit international et à tout le système des Nations unies est la nouvelle conception et doctrine nord-américaines de « guerre préventive » [2]. Par ce biais, les Etats-Unis prétendent donner à l’article 51 de la Charte des Nations Unies un contenu et un sens extensif qui engloberait le droit à la légitime défense à titre « préventif ». Rappelons simplement que la légitime défense, pour être mise en oeuvre, nécessite certaines conditions, parmi lesquelles la riposte proportionnée à une attaque considérée comme étant illégale et contraire à la Charte des Nations Unies.
En déstructurant ce droit politique, est légitimé le déchaînement de la violence des plus puissants : ils partent, au nom d’une nouvelle civilisation, comme jadis l’invasion européenne des terres américaines, en une croisade qui cache mal les politiques et les visées de soumission des peuples et d’appropriation des ressources communes. Et paradoxalement, l’ONU qui devrait être l’élément de contention et de régulation juridique de la violence, participe à la conquête du monde menée par les sociétés transnationales. Désordre mondial, anarchie, déchaînement de la violence des puissants, crise de légitimité, crise de légalité, crise de gouvernabilité mondiale, crise institutionnelle, crise démocratique, voici les principales caractéristiques de la société internationale.
Le Conseil de sécurité n’a plus pour objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales, mais préfère punir les Etats qui s’écartent de l’ordre libéral mondial. Il devient, ainsi, l’organe d’interprétation arbitraire au service des grandes puissances [3]. Le pouvoir discrétionnaire qui lui a été attribué par la Charte des Nations Unies est devenu un pouvoir mis au service des seuls intérêts des plus forts, légitimant leurs stratégies de domination [4] et couvrant des violations graves des règles internationales [5].
Dans ce contexte, et dans un souci de cautionner la loi du plus fort, le Conseil de sécurité a demandé à la Cour Pénale internationale qu’elle n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite pénale à l’égard des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies. Cette décision viserait directement à garantir l’impunité aux responsables de l’Etat tiers qui s’appelle les Etats-Unis [6].
Dès lors, les droits humains deviennent l’argument et l’instrument de déverrouillage du droit « dur » (souveraineté et égalité souveraine des Etats, autodétermination des peuples, interdiction du recours à la force, non intervention...), ce qui justifie toutes interventions et entorses au droit international.
2.La destruction du droit international politique : élément indispensable à l’ordre néo-libéral économique
Cet ordre international basé sur la violence et la loi du plus fort est symétrique à l’ordre économique et social de misère construit exclusivement au nom et pour le profit des intérêts privés.
Le droit international politique mis à l’écart, le terrain devient, ainsi, plus facile pour que se développe le renforcement de règles basées sur la logique de la marchandisation de la société internationale dans son ensemble -suivant les besoins et les vœux des puissantes firmes transnationales assistées des Etats plus petits et des grandes puissances contemporaines-. En contre- partie, un autre droit dur, extrêmement contraignant s’est développé et se met, par le biais d’accords commerciaux, au service des pouvoirs privés et des Etats développés - Accord sur l’OMC, Accords commerciaux multilatéraux et plurilatéraux connexes (AGCS, ADPIC,Agriculture, obstacles techniques au commerce, MSP...)- ou de traités de libre commerce sur le plan régional -NAFTA, CAFTA...- , de traités commerciaux bilatéraux -USA-Chili...-, et de traités de protection des investissements -France-Venezuela ; Bolivie-USA ; Haiti-Allemagne ;etc-.
Le développement de ce droit dur a des conséquences directes sur les compétences étatiques et sur la marge de manœuvre des pouvoirs publics. De fait, le droit interne n’échappe pas à ce nouveau processus de régulation juridique des relations internationales.
Le but de cette réflexion porte sur l’analyse des mutations du droit international et de l’ordre interne en tant que tentative d’appréhension des transformations et de leurs conséquences sur les compétences étatiques et sur les pouvoirs publics dans un contexte de mondialisation libérale.
3.Les changements des relations internationales : le pluralisme et la partie du droit
L’équilibre politique du pouvoir mis en place par le droit international dans le cadre de l’ONU (droit institutionnel et matériel) se trouve remis en question suite aux grandes transformations de la société internationale. Il en va ainsi pour ce qui a trait au droit international général et au droit matériel (Charte de l’ONU) qui ont régulé les relations internationales immédiatement après la deuxième guerre mondiale. Ce droit matériel et ce droit international qui ont "fixé" les rapports de forces dans une période historique déterminée, ancrés sur l’existence de systèmes sociaux, se trouvent aujourd’hui défiés par le processus de réorganisation des relations sociales internationales.
Rappelons quelques principes et règles que le système onusien avait consacrés et toujours en vigueur
– la souveraineté et l’égalité souveraine des Etats
– l’interdiction de l’utilisation de la force
– la coopération internationale et l’obligation de résoudre par des moyens pacifiques les différends
Avec l’arrivée des pays du Tiers Monde, les relations traditionnelles (et par extension le droit international) fondées sur la répartition des zones d’influence hégémonique entre les Etats-Unis et l’URSS, ont subi des modifications profondes. Ces pays, s’appropriant l’AG de l’ONU, ont contribué, d’une part, à des relations internationales plus démocratiques, et d’autre part, au pluralisme juridique.
Ainsi, le droit international échappe partiellement aux puissances et tend à devenir universel. Mais les profondes inégalités et différences de développement font apparaître de nouvelles contradictions, essentiellement liées au problème du développement que les nouveaux Etats ont tenté de résoudre en exigeant que soient énoncés de nouveaux principes en tant qu’interprétation de la Charte des Nations Unies, parmi lesquels
– le droit des peuples à disposer d’eux mêmes
– le droit de choisir son propre système social, économique, social et culturel
– le droit de chaque Etat sur ses ressources naturelles en tant que corollaire à la souveraineté des Etats
– le droit à un environnement sain -étroitement lié au problème du sous-développement et du développement, à la paix et au désarmement- mettant en cause la société de consommation des pays du Nord et plaidant en faveur de relations amicales et de coopération entre les Etats, dans le cadre de la re-formulation des relations économiques internationales [7].
Cette période s’est également caractérisée par l’adoption d’accords et de conventions à très large portée internationale. Ainsi de la Convention de Vienne sur les droit des traités [8], du Pacte sur les droits économiques sociaux et culturels [9], de la Convention sur le droit de la Mer [10] -cette dernière reconnaissant, pour la première fois dans l’histoire, le statut de patrimoine commun de l’humanité aux fonds marins instituant une autorité internationale de gestion des ressources marines.
La revendication de la démocratisation des relations internationales fondées sur de nouvelles règles a atteint son apogée lorsque les gouvernements des pays du Tiers Monde ont proclamé l’instauration d’un Nouvel ordre économique international [11]. Y sont réaffirmés les compétences étatiques et le renforcement du contrôle des pouvoirs publics par le biais de leur pouvoir réglementaire, qui, accompagné par la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats (3281, 12-12-1974) portait, entre autres, sur le contrôle des activités des sociétés transnationales ; leur soumission au droit interne ; le contrôle des investissements ; le contrôle du capital et de son transfert ; le contrôle du commerce international ;le droit à la nationalisation et à l’expropriation.
Soulignons que ce n’est qu’en 1986 que le droit au développement fera officiellement son entrée sur la scène internationale.
Sur le plan politique, l’affirmation de la légalité et de la légitimité de l’action des pouvoirs publics impliquait la maîtrise par l’Etat et ses organes de la formulation et de la mise en place des politiques économiques et sociales, reflétant par là, la primauté des acteurs publics sur les acteurs privés. Nous pouvons dire que durant cette période, l’une des caractéristiques du droit international était sa nature « hétérogène » et relativement « pluraliste ».
Néanmoins, les relations internationales étaient profondément marquées par l’existence de zones d’influence distribuées entre les deux blocs. Existait alors une contradiction essentielle entre la souveraineté des Etats et la réalité de ces zones. Les Etats ont eu recours à l’outil juridique afin de dépasser cette contradiction qui fut matérialisée par la réaffirmation et le développement du principe de « non intervention », contenu dans plusieurs instruments internationaux contraignants, programmatiques ou déclaratifs, mais reflétant le droit coutumier, puisque il s’agissait d’une règle qui s’imposait à tous les Etats.
Notons qu’à ce moment, les revendications des pays du Sud se réduisaient à une sorte de droit international des pauvres qui, dans les faits, n’attendrait jamais l’effectivité.
4.La rupture de l’équilibre et les transformations du droit international
La mondialisation n’est pas un processus purement économique mais revêt aussi des dimensions sociales, politiques, environnementales, culturelles et juridiques qui produit ses effets dans plusieurs domaines de la régulation normative internationale, sur les droits humains1, sur la coopération internationale, sur la paix et la sécurité internationales par le biais de la ré-organisation du pouvoir dans la société internationale.
Un certain nombre de faits, dont la concentration et le développement de firmes privées, la financiarisation de l’économie au détriment de l’économie productive, la création de marchés régionaux (ALENA ; MERCOSUR ; COMMUNAUTE ANDINE ; UE...), et de phénomènes économiques ont bouleversé l’ordre mondial, créant les conditions adéquates pour l’émergence d’un marché mondial, avec des conséquences sur les espaces nationaux mais également sur le droit international. Dans ce contexte, c’est tout l’arsenal juridique dit « pluraliste » « hétérogène » et avec une « tendance à la démocratisation » des rapports internationaux qui s’est trouvé remis en cause. Au-delà de cette remise en cause, c’est le rôle de l’Etat qui est visé.
Ainsi, nous constatons que la régulation juridique internationale et le droit international construit après la seconde guerre mondiale subissent une dégradation généralisée entraînant des répercussions directes sur les règles consacrées par la Charte des Nations Unies, sur le régime juridique international et sur le droit interne des Etats, spécialement en ce qui concerne l’exercice des compétences des pouvoirs publics.
La relation propriété/public, bien public/propriété privée se trouve radicalement modifiée, puisque l’Etat et par voie de conséquence les pouvoirs publics se voient assigner de nouvelles tâches, ce qui n’est pas sans effet sur les règles internationales.
Si sur le plan interne et international, dans cette période des années 70-80, le rôle de l’Etat en tant que régulateur des rapports sociaux était ouvertement revendiqué, de nos jours les compétences étatiques classiques dans le domaine économique, commercial, financier se trouvent profondément érodées.
Cette dégradation est encore aggravée par le fait que les rapports sociaux internationaux et les relations internationales sont façonnés par une structure unipolaire avec le rôle dominant des Etats-Unis aussi bien militairement qu’idéologiquement puisqu’ils se présentent et apparaissent comme seul modèle social.
Cette prééminence et cette domination, dans le contexte de l’extension planétaire d’un seul modèle social et la montée en puissance de firmes privées (sociétés transnationales, capital financier lié aux activités des banques du Nord), produisent des effets directs sur la déstructuration des règles " anciennes" et sur la consolidation de "nouvelles règles" [l’utilisation de cette expression obéit plutôt à un souci de simplification].
Dans les faits, il s’agit de la réaffirmation de règles classiques revendiquées par le droit occidental : proclamer, matérialiser et développer par le biais du phénomène juridique international, la primauté des intérêts privés sur les bien publics à travers, par exemple, l’interdiction d’exproprier, la nationalisation, le respect des droits acquis, ou par des règles poussant la libéralisation des flux des investissements, la libéralisation du commerce, le renforcement du régime des droits de propriété intellectuelle....
5.Le glissement vers un droit international de caractère uniforme et uniformisant
Le passage du droit international hétérogène vers un droit uniforme se produit dans un contexte mondial de réorganisation sociale, économique, financière, culturelle. Le droit international de nature économique et commercial est, sans conteste, le corpus juridique qui reflète le mieux les mutations de l’ordre politico-juridique du monde. Le droit international en formation, en tant que phénomène socio-politico-juridique, est un droit de nature mercantiliste, corporative dont la tendance généralisée est de soumettre les règles et principes (y compris ceux régissant les droits humains) à la logique des principes et des pratiques marchandes. Somme toute, c’est un droit international positiviste et anti-démocratique. Positiviste parce que formaliste. En effet, le droit international mercantiliste et « privatiste » joue un rôle idéologique de premier ordre. Il camoufle à la fois les réalités et les objectifs de puissance et de violence. Il en va ainsi de la lecture et de l’analyse d’un traité sur la promotion et la protection des investissements. Il existe, parce que l’Etat a donné son accord et qu’il a librement consenti à assumer ses obligations internationales. Il en va ainsi de l’obligation de protection du capital privé en toutes circonstances, y compris dans des situations de guerre, de révolution, d’insurrection, de troubles sociaux, de conflit armé ou de tout évènement similaire [12]. Il est anti-démocratique car il constitue la négation même du pluralisme : il n’ y a qu’un seul modèle social international : le libéralisme.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que des organisations internationales telles le FMI, BM et l’OMC connaissent un renforcement institutionnel et politique [13] jouant un rôle clé dans le processus de la « ... contre-révolution libérale... » [14] Ces trois piliers des relations économiques internationales sont renforcés à leur tour par une instance informelle (G 8), où des décisions stratégiques sont prises sans aucun contrôle. Le régime international de libre-échange contribue de manière substantielle à la neutralisation des normes internationales en matière de la protection des droits humains, en portant directement atteinte à l’intégrité physique, à la liberté des personnes et au droit à la participation [15].
Le droit international devient la prolongation des intérêts privés et fixe la primauté de ces mêmes intérêts sur l’intérêt général. C’est ainsi que les règles de l’OMC sont construites à la mesure des intérêts privés, sans que ces derniers aient une quelconque obligation à respecter età faire respecter les droits humains. En revanche, selon le régime juridique de l’OMC, l’Etat et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que ses règles soient appliquées correctement.
La responsabilité face au secteur privé revient à l’Etat, tandis que ce dernier n’a que des droits et des libertés juridiquement garantis. Le secteur privé n’a aucune obligation à l’égard des citoyens et encore moins à l’égard du secteur public. Nous sommes devant un processus dialectique de responsabilisation/ dé-responsabilisation, le premier étant à la charge de l’Etat et des pouvoirs publics.
L’un des domaines où nous pouvons mieux déceler la dé- responsabilisation accrue du capital privé ou du secteur privé est celui des Codes de conduite qui sont de vrais instruments de légitimation de ce droit corporatif et cheval de bataille des Institutions multilatérales comme le FMI, la Banque Mondiale, l’OMC, l’OCDE, l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle -OMPI-, etc....
Les pouvoirs privés transnationaux imposent ainsi, dans certains domaines, des zones de non- droit où la régulation juridique normale (là où on viole une norme il y a sanction, plus encore quand il s’agit de crimes contre l’humanité) est remplacée par la catégorie éthique et moralisatrice. Les impératifs d’ordre moral apparaissent ainsi en lieu et place du droit politique. Ces codes de conduite consacrent une pratique qui est assimilable à « l’autolimitation » auréolée de règles non contraignantes (droit mou, fiction juridique ou pseudo-droit ?) dont l’exécution est laissée au libre arbitre du secteur privé ; leurs violations ne comportant aucune sanction de nature juridique [16] .
Inversement et à titre d’exemple, un domaine où il est possible de déceler la responsabilisation accrue de l’Etat (et en conséquence, la re-formulation du rôle de l’Etat) et des pouvoirs publics est celui des traités pour la promotion et la protection des investissements (TPPI), encadrés idéologiquement par la nécessité de la « bonne gouvernance » ou plus simplement de la « gouvernance ».
Ces traités interdisent, en fait et en droit, la mise en place de politiques publiques qui pourraient nuire aux investisseurs privés. Ainsi, tous ces traités contiennent des clauses interdisant l’expropriation, la nationalisation, la confiscation ou la prise de mesures -qu’elles soient législatives, réglementaires, judiciaires, environnementales ou sociales...- produisant des effets similaires. Le CIRDI, organe chargé d’interpréter et d’appliquer le droit des TPPI ne s’est pas privé de faire des interprétations rappelant aux Etats que même des réglementations environnementales destinées à protéger la vie et la santé des populations sont des raisons d’expropriation [17].
La responsabilité internationale de l’Etat peut être ainsi mise en cause directement par le recours auprès du CIRDI de la part des investisseurs privés, sans que ceux-ci aient même obligation d’épuiser les recours internes, privilège dont ne jouit aucun citoyen du monde lorsqu’il s’agit de violations des droits humains ! Ce « nouveau droit », très contraignant pour les pouvoirs publics, a introduit un virage radical en matière de responsabilité internationale de l’Etat : la responsabilité n’est plus seulement revendiquée d’Etat à Etat, mais devant des firmes privées.
6.Le redéploiement de l’Etat : la redéfinition de son rôle
Sur le plan politico-idéologique, les tenants de la mondialisation libérale ont mené une offensive contre l’Etat en tant qu’agent régulateur des rapports sociaux.
Du coup, l’Etat, en tant qu’institution, et par extension les pouvoirs publics, se trouve au milieu d’une profonde crise de légitimité. En effet, partout dans le monde (avec des particularités propres à chaque région et à chaque culture) l’Etat et les pouvoirs publics sont en plein recul face aux intérêts privés.
Selon la Banque mondiale, dans un rapport qui fait date, le rôle de l’Etat est de développer le marché par le biais de règlements bien conçus car "...l’initiative privée est paralysée par la survivance des relations antagoniques entre l’Etat et le marché..." [18]. Un Etat, et tout pouvoir public qui refuserait cette nouvelle fonction est assimilé à l’arbitraire, car "...la privatisation est une solution évidente" [19] et doit rester une priorité [20].
L’attaque contre l’Etat et les pouvoirs publics ont des conséquences politiques assez larges car il s’agit d’une idéologie anti-étatique (sur le plan social, économique, commercial et financier). Cette offensive vise à délégitimer l’Etat. D’ailleurs, l’ONU, par le biais de son Secrétaire général, ne se prive pas de rappeler que les pouvoirs publics doivent mener des politiques économiques dynamiques et favorables au secteur privé [21] ; la société civile, et les institutions internationales devant s’associer à cet idéal au service de la liberté [22] par le biais d’une bonne gouvernance [23] , afin de lutter ensemble contre le terrorisme [24].
L’intervention des pouvoirs publics dans le domaine économique et social, de même que leurs réglementations, sont considérées comme empêchant la liberté du commerce et comme des barrières non tarifaires ou des obstacles techniques au commerce.
La diminution du rôle de l’Etat, pièce maîtresse de cette offensive, se manifeste par un affaiblissement général
– en tant que re-distributeur des richesses par la politique fiscale
– comme élément stimulateur du plein emploi par des travaux publics, subsides ou aides
– comme stimulateur de la consommation
– comme entité publique de contrôle des flux monétaires et financiers
– en tant qu’agent d’administration et de gestion de l’économie et du commerce international
Avec cette diminution, c’est également tout le pouvoir réglementaire des pouvoirs publics ainsi que les politiques publiques de développement économique et social qui sont visés. Les services publics, les biens communs, les biens publics se trouvent remis en question au profit du développement du secteur privé.
Néanmoins, l’Etat reste l’un des acteurs principaux des relations internationales et la crise actuelle de légitimité et d’érosion des compétences ne signifie pas sa disparition. Loin de là, il s’agit de reformuler son rôle et avec celui-ci de définir les contours de l’action des pouvoirs publics et d’établir un cadre de régulation propice au développement du secteur privé.
En même temps que l’érosion des compétences se poursuit, l’Etat devient de plus en plus répressif et de plus en plus axé sur la charité, la morale ou la compassion, voire les trois ensemble [25].
La contrepartie à la perte des compétences sur le plan social, économique et financier est le renforcement à la fois de l’Etat-pénal et de l’Etat Ambulance [26] .
Sur le plan international, nous assistons au développement généralisé de la charité, d’action moralisatrice et de compassion envers les plus pauvres : missions humanitaires, ONG de l’humanitaire, assistances médicales d’urgence en Afrique, en Amérique Latine...
7.Libéralisme économique/bonne gouvernance/démocratie libérale : un seul et même combat
Dans l’état actuel des rapports de forces au sein des relations internationales prédomine une conception purement formaliste de la démocratie, axée sur le droit à des élections libres et périodiques. La conception libérale cache qu’il s’agit d’une démocratie purement formelle, réduite à son expression minimale : il s’agit du vote des citoyens (exercice, certes, indispensable), et non d’un processus. Cette conception cache aussi le fait que la démocratie libérale est synonyme de liberté du marché en tant que seul et unique modèle, ce qui relève de la pure idéologie.
C’est dans ce contexte que la "gouvernance" (quelque soit le qualificatif qu’on lui adjoint -bonne, mondiale, globale, locale, nationale, régionale, sous-régionale, municipale-), en tant que catégorie idéologico-politique, sert de pivot au dépassement des contradictions.
L’Etat et les pouvoirs publics (y compris les organisations internationales), réduits au rôle de gestionnaires, doivent assumer un nouveau rôle, celui d’assurer "une bonne gouvernance", une "bonne gestion des affaires publiques".
Plus concrètement, la notion de gouvernance acquiert statut international autour des années 1990, notamment comme conséquence à la vague libérale qui déferle, à partir des années 1980, en Occident et à l’écroulement du bloc socialiste, à la fin de l’année 1989, lors de la chute du Mur de Berlin.
Rapidement, les points forts de cette vague sont une remise en question du rôle de l’État et une approche radicalement libérale de l’économie. Citons trois des caractéristiques principales de la gouvernance.
1) La recherche de l’État minimal ; démission de l’Etat dans les domaines économique et social
2) Elle s’inspire du modèle de gestion de l’entreprise privée, c’est-à-dire une volonté d’abattre les hiérarchies afin que les relations de pouvoir soient « plus souples, fondées sur le dialogue, la négociation et le compromis ». L’Etat deviendrait ainsi un grand espace neutre où les conflits seraient gérés, atténués et si possible éliminés, au profit du dialogue entre les acteurs principaux représentés par la société civile, le secteur privé et ceux qui politiquement gèrent la bonne gouvernance.
3) la bonne gestion -ce qui implique qu’il y aurait une « bonne gouvernance » synonyme de gouvernance libérale, là où « une gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières » est effectivement assurée ce qui dans la pratique se traduit par la démission des pouvoirs publics et de leur rôle réglementaire au profit des privatisations sur le plan social, économique, environnemental,.
C’est également depuis les années 1990 que les organisations financières internationales -principalement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale- prônent régulièrement aux pays membres (surtout ceux du Sud) des recommandations de « bonne gouvernance », expression très controversée et dont les contours juridiques demeurent imprécis, pouvant aussi être entendue comme entreprise à portée globale ou catégorie qui devrait être assumée par toutes les institutions internationales.
Le FMI demande aux pays bénéficiant de son assistance technique l’application de politiques économiques, commerciales et financières à travers son code de bonne gestion publique qui vise à rendre plus transparentes les décisions de politiques économiques, à accéder au maximum d’informations sur les finances publiques, à normaliser les pratiques de contrôle et, depuis peu, à « combattre le financement du terrorisme ».
La Banque mondiale, quant à elle, précise que la gouvernance doit aider les pays membres d’une part, à mettre fin au dysfonctionnement du secteur public et d’autre part, les encourager dans la mise en place de « réformes » destinées à améliorer les mécanismes d’allocation de ressources publiques et les aménagements institutionnels de l’État.
Dans tous les cas, et avec toutes les nuances possibles, la bonne gouvernance vise non pas le développement de la participation démocratique des individus et des populations aux processus de décisions, moins encore le respect de leur droit au développement ou de leurs droits humains ; elle cherche à pousser les États -nations à déréguler les marchés par une réglementation qui leur [27] est favorable.
Bien que le concept de bonne gouvernance soit indéterminé sur le plan normatif, les objectifs formulés par ces organisations ne sont pas ambigus mais plutôt clairs et convergents : ils visent l’inflexion des politiques des États (et des pouvoirs publics) dans le sens de l’instauration d’environnements institutionnels très ou plus favorables à l’ouverture des pays (principalement du Sud) aux marchés financiers globalisés. La gouvernance joue ainsi un rôle de légitimation de la mondialisation libérale et du droit international marchand, au détriment des droits (humains, civils et politiques, économiques sociaux et culturels) et des pratiques démocratiques.
La bonne gouvernance des Etats passe par la libre adaptation des standards internationaux, par exemple, par l’OMC ou par les traités de promotion et de protection des investissements afin que les Etats « s’interdissent d’interdire ».
Tout le problème réside là : le modèle de gouvernance proposé véhicule un système de valeurs et des idéologies qui mettent en avant le profit et la liberté du marché avec des initiatives désordonnées dans un pluralisme échevelé, évacuant le politique et la démocratie » [28] .
Pistes de réflexion
L’un des défis majeurs consiste dans la nécessité de démocratiser les relations internationales en général, et les relations internationales économiques en particulier. Cela suppose l’existence d’une société internationale avec un système de pluralisme juridico-politique qui passe par la reconnaissance de l’existence de modèles sociaux différents, de modèles démocratiques pluralistes et de moyens diversifiés dans la recherche du développement local, régional et international.
A son tour, la construction d’un nouveau cadre juridique et institutionnel international exige la création d’une nouvelle dynamique des forces, sa solidification et sa consolidation.
La démocratisation des relations internationales passe par la réforme radicale des organisations internationales, en particulier celle de l’ONU, du FMI, de la BM et de l’OMC. Les institutions financières et commerciales internationales doivent être soumises au droit international général, à la Charte des Nations Unies et aux obligations concernant la protection internationale des droits humains, cette dernière comportant des mécanismes de contrôle, de suivi, d’évaluation et de sanction adéquats.
Cela étant, sur le plan international, il est impératif qu’il y ait un cadre normatif consacrant la primauté de l’INTERET GENERAL, sur l’intérêt privé. Pour cela, Il est également nécessaire que les Biens communs publics mondiaux soient clairement consacrés en tant que norme juridique.
Sur le plan national, local ou régional, il est essentiel que les biens publics devenus privés (l‘ eau, l’électricité, le transport,...) retournent au domaine public et soient soumis au contrôle démocratique citoyen.
Mireille Mendès France : IPAM (Initiative pour un autre monde) et membre de Droit-solidarité/AIJD
Hugo Ruiz Diaz Balbuena : Docteur en Droit international