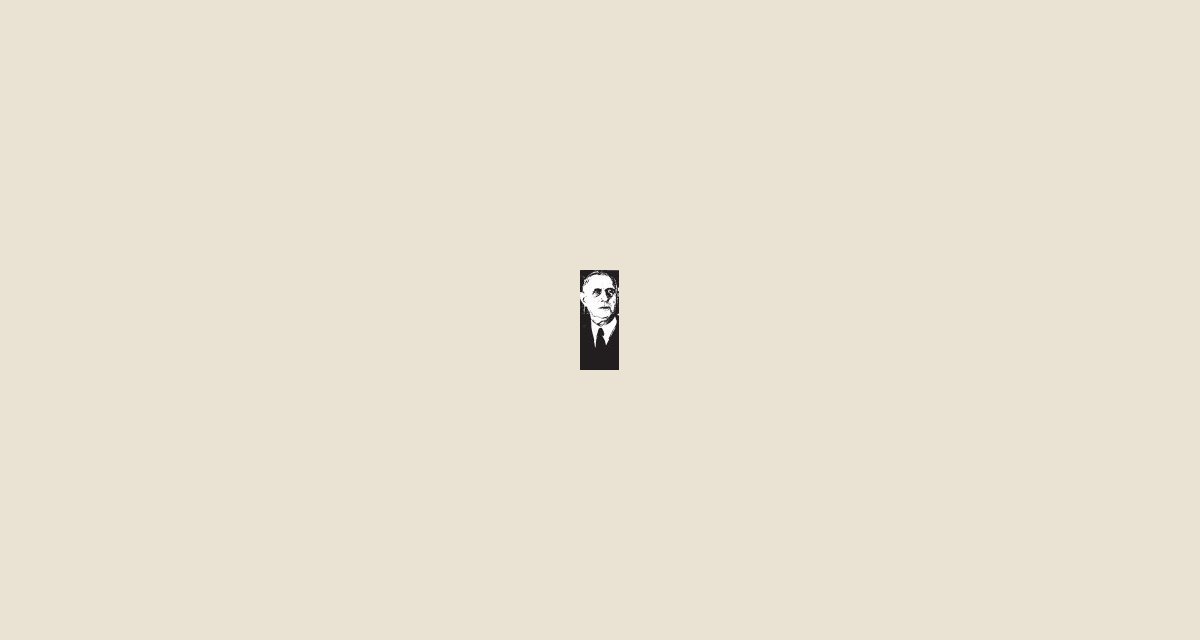En 1967, le général De Gaulle met
en garde contre les risques de
guerre au Proche-Orient. Historiens,
Samir Kassir (assassiné le 2 juin 2005
à Beyrouth) et Farouk Mardam-Bey, dans
la véritable somme qu’ils ont publiée sur
la politique française au Proche-Orient [1], évoquent, en interrogeant le changement
dans les relations franco-israliennes en
1967, les motivations du général De
Gaulle. Ils soulignent notamment sa
« volonté d’affirmer la présence de la
France dans le jeu international » et sa
« volonté d’apaisement ». Il craignait,
soulignent les chercheurs, que la tension
entre les blocs s’amplifie en cas de guerre
au Proche-Orient au point de dégénérer.
Et, ayant « pris la mesure du rapport des
forces » défavorable aux pays arabes, « il
avait acquis la certitude que la guerre
n’était pas nécessaire pour assurer la
survie d’Israël ». Une vision qui le conduira
à aller à l’encontre de ce qu’était alors
majoritairement l’opinion française.
Sans épouser les positions des Etats arabes,
De Gaulle condamnera l’agression puis
l’occupation israélienne des territoires
conquis par la guerre, sans pour autant
évoquer les Palestiniens. Il fera de la philosophie
de la résolution 242 celle de la
politique française, telle que la suivront
et la compléteront ses successeurs. Alors
que la France était fournisseuse d’armements
à Israël, le général De Gaulle (après
de nouveaux raids israéliens, comme au
Liban) décide l’embargo en janvier 1969.
De sa conférence de presse du 27
novembre 1967, certains n’ont retenu
qu’une formule soulevant alors les passions,
laquelle qualifiait « les juifs,
jusqu’alors dispersés », de « peuple d’élite,
sûr de lui-même et dominateur ». La très
longue intervention de De Gaulle se veut
en fait un regard sur l’histoire, les ambitions
s’exprimant de part et d’autre, les
rapports de forces, les conditions d’un
règlement et le rôle de la France. Et
d’énoncer le mécanisme du cycle occupation,
résistance, répression : « Maintenant,
il (Israël) organise sur les territoires
qu’il a pris l’occupation qui ne
peut aller sans oppression, répression,
expulsions, et il s’y manifeste contre lui
une résistance, qu’à son tour il qualifie
de terrorisme »...
Quarante ans plus tard, il semble important,
à la lumière de l’histoire, de relire
l’intervention de Charles de Gaulle dans
son intégralité [2].

Fin des années 60. © Collection de photographies de la fondation Charles De Gaulle.
Un discours précurseur
« L’établissement, entre les deux guerres
mondiales, car il faut remonter jusque
là, l’établissement d’un foyer sioniste
en Palestine et puis, après la deuxième guerre mondiale,
l’établissement d’un Etat d’Israël, soulevaient,
à l’époque, un certain nombre d’appréhensions.
On pouvait se demander, en effet, et on
se demandait même chez beaucoup de juifs, si
l’implantation de cette communauté sur des terres
qui avaient été acquises dans des conditions plus
ou moins justifiables et au milieu des peuples
arabes qui lui étaient foncièrement hostiles,
n’allait pas entraîner d’incessants, d’interminables
frictions et conflits. Certains même redoutaient
que les juifs, jusqu’alors dispersés, qui
étaient restés ce qu’il avaient été de tout temps,
un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur,
n’en viennent, une fois qu’ils seraient rassemblés
dans le site de leur ancienne grandeur,
à changer en ambition ardente et conquérante
les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis
dix-neuf siècles : l’an prochain à Jérusalem.
Cependant, en dépit du flot tantôt montant tantôt
descendant des malveillances qu’ils provoquaient,
qu’ils suscitaient plus exactement, dans certains pays
et à certaines époques, un capital considérable
d’intérêt et même de sympathie s’était accumulé
en leur faveur, surtout, il faut bien le dire, dans
la chrétienté ; un capital qui était issu de l’immense
souvenir du Testament, nourri par toutes les source
d’une magnifique liturgie, entretenu par la commisération
qu’inspirait leur antique malheur et
que poétisait chez nous la légende du Juif errant,
accru par les abominables persécutions qu’ils
avaient subies pendant la deuxième guerre mondiale,
et grossi depuis qu’ils avaient retrouvé une
patrie, par leurs travaux constructifs et le courage
de leurs soldats.
C’est pourquoi, indépendamment des vastes concours
en argent, en influence, en propagande, que les
Israéliens recevaient des milieux juifs d’Amérique
et d’Europe, beaucoup de pays, dont la France,
voyaient avec satisfaction l’établissement de leur
Etat sur le territoire que leur avaient reconnu les
Puissances, tout en désirant qu’ils parviennent, en
usant d’un peu de modestie, à trouver avec leurs
voisins un modus vivendi pacifique.
Il faut dire que ces données psychologiques avaient
quelque peu changé depuis 1956, à la faveur de
l’expédition franco-britannique de Suez on avait
vu apparaître en effet, un Etat d’Israël guerrier
et résolu à s’agrandir. Ensuite, l’action qu’il
menait pour doubler sa population par l’immigration
de nouveaux éléments, donnait à penser
que le territoire qu’il avait acquis ne lui suffirait
pas longtemps et qu’il serait porté, pour l’agrandir,
à saisir toute occasion qui se présenterait.
C’est pourquoi, d’ailleurs, la Vème République
s’était dégagée vis-à-vis d’Israël des liens spéciaux
et très étroits que le régime précédent avait
noués avec cet Etat, et s’était appliquée au contraire
à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien
sûr, nous conservions avec le gouvernement israélien
des rapports cordiaux et, même, nous lui
fournissions pour sa défense éventuelle, les armements
qu’il demandait d’acheter. Mais, en même
temps, nous lui prodiguions des avis de modération, notamment à propos des litiges qui concernaient
les eaux du Jourdain ou bien des escarmouches
qui opposaient périodiquement les forces
des deux camps. Enfin, nous nous refusions à
donner officiellement notre aval à son installation
dans un quartier de Jérusalem dont il s’était
emparé et nous maintenions notre ambassade à
Tel-Aviv.
Une fois mis un terme à l’affaire algérienne, nous
avions repris avec les peuples arabes d’Orient la
même politique d’amitié, de coopération qui
avaient été pendant des siècles celle de la France
dans cette partie du monde et dont la raison et
le sentiment font qu’elle doit être aujourd’hui
une des bases fondamentales de notre politique
extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas
ignorer aux Arabes que, pour nous, l’Etat d’Israël
était un fait accompli et que nous n’admettrions
pas qu’il fût détruit. De sorte qu’on pouvait imaginer
qu’un jour viendrait où notre pays pourrait
aider directement à ce qu’une paix fût conclue
et garantie en Orient, pourvu qu’aucun drame
nouveau ne vînt la déchirer.
Hélas ! Le drame est venu. Il avait été préparé par
une tension très grande et constante qui résultait
du sort scandaleux des réfugiés en Jordanie, et aussi
d’une menace de destruction prodiguée contre
Israël. Le 22 mai, l’affaire d’Aqaba, fâcheusement
créée par l’Egypte, allait offrir un prétexte
à ceux qui rêvaient d’en découdre. Pour éviter les
hostilités, la France avait, dès le 24 mai, proposé
aux trois autres grandes puissances d’interdire,
conjointement avec elle, à chacune des deux parties
d’entamer le combat. Le 2 juin, le gouvernement
français avait officiellement déclaré, qu’éventuellement,
il donnerait tort à quiconque entamerait
le premier l’action des armes, et c’est ce que
j’avais moi-même, le 24 mai dernier, déclaré à
Monsieur Eban, ministre des Affaires étrangères
d’Israël, que je voyais à Paris. “Si Israël est attaqué”,
lui dis-je alors en substance, “nous ne le
laisserons pas détruire, mais si vous attaquez,
nous condamnerons votre initiative. Certes, malgré
l’infériorité numérique de votre population,
étant donné que vous êtes beaucoup mieux organisés,
beaucoup plus rassemblés, beaucoup mieux
armés que les Arabes, je ne doute pas que le cas
échéant, vous remporteriez des succès militaires,
mais ensuite, vous vous trouveriez engagés sur le
terrain et au point de vue international, dans des
difficultés grandissantes, d’autant plus que la
guerre en Orient ne peut pas manquer d’augmenter
dans le monde une tension déplorable et
d’avoir des conséquences très malencontreuses
pour beaucoup de pays, si bien que ce serait à
vous, devenus des conquérants, qu’on en imputerait
peu à peu les inconvénients.”
On sait que la voix de la France n’a pas été entendue.
Israël, ayant attaqué, s’est emparé, en six
jours de combat, des objectifs qu’il voulait atteindre.
Maintenant, il organise sur les territoires qu’il a
pris l’occupation qui ne peut aller sans oppression,
répression, expulsions, et il s’y manifeste contre
lui une résistance, qu’à son tour il qualifie de
terrorisme. Il est vrai que les deux belligérants
observent, pour le moment, d’une manière plus
ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu
prescrit par les Nations unies, mais il est bien
évident que le conflit n’est que suspendu et qu’il
ne peut y avoir de solution sauf par la voie internationale.
Un règlement dans cette voie, à moins que les
Nations unies ne déchirent elles-mêmes leur
propre charte, doit avoir pour base l’évacuation
des territoires qui ont été pris par la force, la fin
de toute belligérance et la reconnaissance réciproque
de chacun des Etats en cause par tous
les autres. Après quoi, par des décisions des
Nations unies, en présence et sous la garantie de
leurs forces, il serait probablement possible
d’arrêter le tracé précis des frontières, les conditions
de la vie et de la sécurité des deux côtés,
le sort des réfugiés et des minorités et les modalités
de la libre navigation pour tous, notamment
dans le golfe d’Aqaba et dans le canal de
Suez. Suivant la France, dans cette hypothèse, Jérusalem
devrait recevoir un statut international.
Pour qu’un tel règlement puisse être mis en oeuvre,
il faudrait qu’il y eût l’accord des grandes puissances
(qui entraînerait ipso facto celui des Nations
unies) et, si un tel accord voyait le jour, la France
est d’avance disposée à prêter sur place son
concours politique, économique et militaire, pour
que cet accord soit effectivement appliqué.
Mais on ne voit pas comment un accord quelconque
pourrait naître non point fictivement sur
quelque formule creuse, mais effectivement pour
une action commune, tant que l’une des plus
grandes des quatre ne se sera pas dégagée de la
guerre odieuse qu’elle mène ailleurs. Car tout se
tient dans le monde d’aujourd’hui. Sans le drame
du Vietnam, le conflit entre Israël et les Arabes
ne serait pas devenu ce qu’il est et si, demain, l’Asie
du Sud-Est voyait renaître la paix, le Moyen-Orient
l’aurait bientôt recouvrée à la faveur de la détente
générale qui suivrait un pareil événement. »