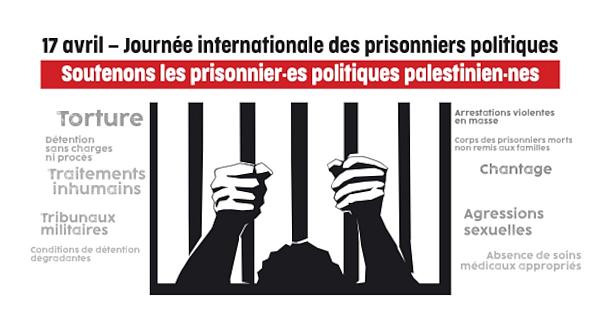Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, une liste d’organisations terroristes est établie par l’Union européenne qui vise individus et entités « impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives » [1]]. Dans sa dernière mise à jour réalisée en 2021, on note des incohérences, voire des absurdités. Constat qui interroge la pertinence de cette liste comme outil de politique étrangère.
Ne compromet-elle pas le rôle de l’UE dans la résolution des conflits en interdisant les relations avec des acteurs majeurs, qui par ailleurs n’interviennent pas sur le sol européen ?
Par exemple : la branche politique du Hamas (en toute hypothèse, incontournable pour d’éventuelles négociations de paix) est curieusement listée avec sa branche armée, alors que le FPLP est inscrit sans sa branche armée. Cependant, les exposés des motifs n’étant pas publics, les raisons de ces différences sont inconnues. Qui plus est, si on peut théoriquement retirer de la liste une organisation dont les positions auraient évolué, l’inscription se révèle en réalité indélébile en raison de la lourdeur des procédures de révision : la décision finale est prise à l’unanimité par le Conseil (source N. Janne). Lourdeur qui s’explique par les pressions permanentes des lobbies les plus puissants.
Les résistants des uns sont plus que jamais les terroristes des autres, et les voix des plus forts contrôlent les arbitrages. Dès lors, plutôt que de s’interroger sur les contradictions, voire les non-sens de cette liste, l’UE va progressivement élargir son impact, tout particulièrement au plan financier.
C’est ainsi que sont apparues, les « conditions générales applicables aux subventions financées par l’UE » en direction des ONG. Cette clause impose une exigence nouvelle : s’assurer qu’aucun des bénéficiaires, que ce soient « des sous-traitants, des personnes physiques, y compris des participants à des ateliers et/ou à des formations, [ou] des bénéficiaires d’aides financières via des tierces parties », ne figure dans les « listes des mesures restrictives de l’Union européenne » En clair, qu’ils ne soient pas affiliés à une organisation « terroriste ».
Des exigences irrecevables
Début 2020, l’ONG Badil (Centre de Ressources pour la Protection des Palestiniens et pour les Droits des Réfugiés), qui a un statut consultatif reconnu au Conseil Économique et Social des Nations unies prend la tête de la protestation. Quelques 300 ONG palestiniennes signent l’appel « contre le terrorisme et contre les financements conditionnels » qui stipule notamment : « Ces dernières années, les campagnes israéliennes qui ciblent la société civile palestinienne et ses ONG se sont intensifiées.
Parallèlement, les contraintes de financement des différents donateurs se sont accrues. […] Cette escalade ne peut être séparée de toutes les politiques et approches visant à anéantir les droits nationaux palestiniens. ». L’appel précise : « Les conditions posées par l’UE, ou par toute autre institution de financement qui portent atteinte à l’histoire, à la dignité et aux droits de notre peuple sont rejetées, nationalement, légalement et moralement ».
La réponse ne tarde pas : le 12 juin 2020, l’UE informe Badil que tous ses financements sont annulés en raison de son refus de signer la nouvelle clause. Rapidement, l’ONG perd cinq de ses principaux bailleurs de fonds. Des centaines d’organisations palestiniennes se retrouvent dans la même situation. Depuis, toutes subissent l’aggravation des contraintes imposées par un nombre grandissant de donateurs. Ainsi, la Suède, qui traditionnellement soutenait nombre d’initiatives en Palestine, a adopté les restrictions européennes.
Les Pays-Bas viennent de prendre la même décision.
Colère
En France, le gouvernement s’est empressé de s’aligner, provoquant la colère des associations humanitaires. Médecins du monde, Action contre la faim, Handicap international et la Coordination Sud (qui regroupe 180 ONG de solidarité internationale) se tournent vers le Conseil d’État pour demander en urgence la suspension de ces « lignes directrices » qu’elles jugent inapplicables. Le 31 mars dernier, le juge des référés – qui n’est pas compétent pour statuer sur le fond des dossiers – a estimé que, l’urgence du problème n’étant pas avérée, il ne pouvait pas suspendre la mesure dans l’immédiat. Il reste maintenant au Conseil d’État à statuer sur le fond. Mais le gouvernement français n’en reste pas là : il impose à l’Agence française de développement (AFD) d’appliquer les financements conditionnels et, à partir de juillet 2022, de renforcer les mesures de « criblage » (c’est-à-dire de surveillance méticuleuse des transferts de fonds). Est-il nécessaire de rappeler que cette agence de financement est chargée par l’État d’« accélérer les transitions vers un monde plus juste et durable » (sic) ?
Contrôles tatillons
D’une façon générale, les banques tendent aujourd’hui à bloquer des virements vers la Palestine (tout particulièrement vers Gaza), parfois sans explication, parfois alors que le destinataire ne fait aucun « doute ». L’AFPS, comme beaucoup d’autres, se heurte à ces difficultés. La situation semble d’autant plus inique qu’il arrive que le simple fait d’être opposé à l’apartheid israélien soit une raison suffisante pour être suspect, et - pour le moins - faire l’objet de contrôles tatillons. Comportement d’autant plus incompréhensible que l’UE a condamné la France à indemniser des militants de l’AFPS jugés coupables d’avoir appelé au boycott des produits des colonies israéliennes, considérant qu’il s’agissait d’une opinion politique et non d’un délit.
Comment expliquer ce zèle ? Tout d’abord, parce que les banques sont tenues de respecter les exigences du « dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes ».
Ainsi, dans son « Plan d’action 2021-2022 », l’État précise : « Les autorités françaises développent une stratégie large d’entrave à l’égard des structures à risque, porteuses d’une menace de radicalisation violente sans être directement impliquées dans des infractions terroristes ». Et de façon encore plus claire : « Nous proposerons de renforcer les contrôles et le suivi des organismes à but non lucratif qui présentent des risques en matière de financement du terrorisme afin d’éviter leur dévoiement ». Ainsi, statutairement, les banques doivent connaître le donneur d’ordre, le bénéficiaire et l’objet de toute transaction financière pour être en mesure d’en rendre compte, sous peine de sanctions. Les risques sont en effet élevés, tout particulièrement lorsque les transactions se font en dollars ; dans ce cas, le droit américain est susceptible de s’imposer. Les États-Unis s’arrogent en effet un pouvoir d’extraterritorialité exorbitant dès qu’on utilise leur monnaie, quel que soit l’endroit du monde où la transaction intervient. Les banques sont donc particulièrement frileuses face aux risques de pénalités colossales qu’elles encourent (en 2015, BNP Paribas et HSBC ont dû payer près de 10 milliards de dollars d’amende au trésor américain pour avoir contourné l’embargo sur le Soudan, l’Iran, Cuba et la Libye).
Débordements idéologiques
On comprend ainsi comment un principe, légitime au départ, donne lieu à des débordements politiques et idéologiques inadmissibles, encouragés par les pressions permanentes des affidés du gouvernement israélien, puis appliqués sans sourciller par des opérateurs craintifs de se voir accusés de manque de vigilance ou pire, de complicité antisémite. Dans le même temps, 627 institutions financières européennes soutiennent sans états d’âme 50 entreprises activement impliquées dans les colonies israéliennes. En tête BNP Paribas, avec plus de 20 milliards de dollars d’investissements ou de prêts à 27 de ces entreprises.
On est loin des principes de « Diligence raisonnable en matière de Droits Humains » prônés par l’ONU depuis 2011. Principes que la banque a appliqués à la Russie avec célérité en réponse à l’invasion de l’Ukraine. L’expression « deux poids, deux mesures » prend ici tout son sens. Sur le plan financier tout d’abord, avec le soutien aux colonies – pourtant illégales –, alors qu’on étouffe sournoisement la société civile palestinienne – pourtant légitime –, si l’on en croit le credo international pour une « solution à deux États ». Sur le plan éthique ensuite, par la négation persistante de la persécution des Palestiniens, quand la sanction frappe sans délai le bourreau russe des Ukrainiens.
Bernard Devin
>> Consulter et télécharger l’ensemble du n°81 de la Revue PalSol
—