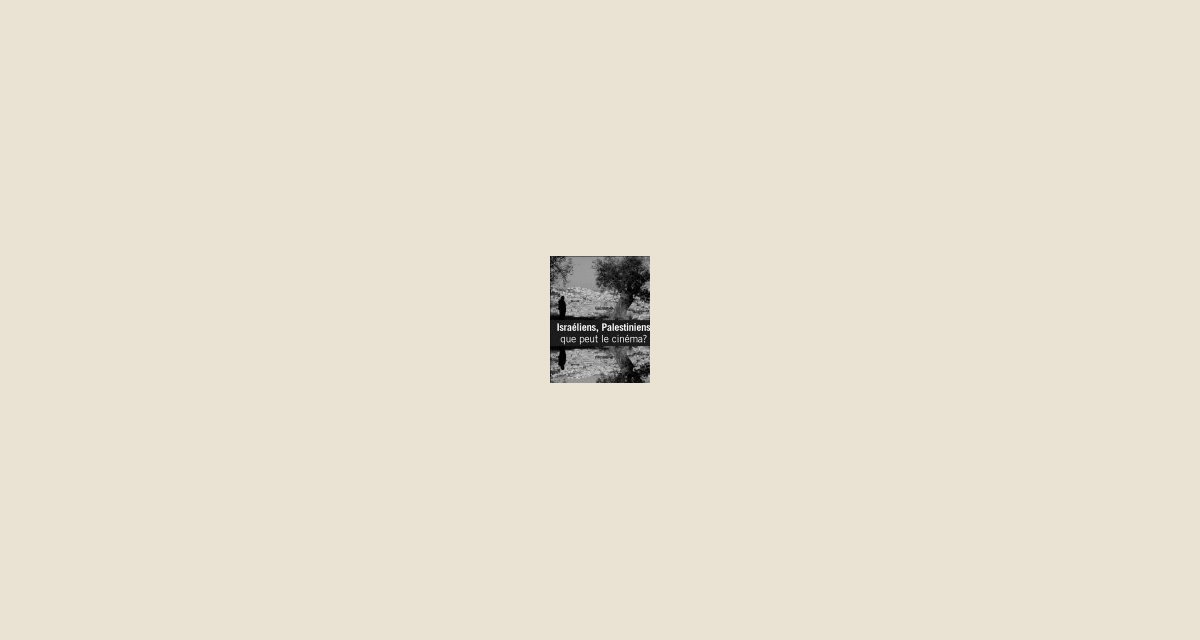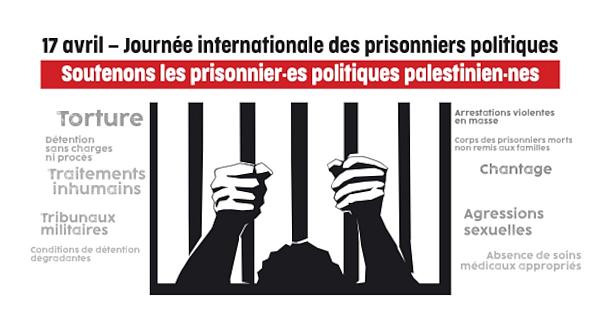Janine Halbreich-Euvrard est critique
de cinéma. Depuis longtemps engagée
pour la Palestine elle a été l’une des premières
à comprendre l’importance du
cinéma palestinien et israélien dans la
compréhension du conflit. Elle s’est rendue
en mars 2004 dans les territoires
occupés et en Israël à la rencontre de
réalisateurs israéliens et palestiniens
Son livre Israéliens, Palestiniens, que
peut le cinéma ? est le résultat de ces
rencontres. Il est la suite écrite du festival
« D’ici et d’ailleurs, Israéliens et
Palestiniens, que peut le cinéma ? »
qu’elle a organisé en 2003 à Paris. Le
livre est un carnet de route, un road
book du film entre les territoires occupés
et Israël. Chaque étape est l’occasion
de rencontrer ceux qui font le cinéma
palestinien et israélien. L’auteur nous
transporte en Cisjordanie, devant le Mur,
dans le camp de réfugiés de Deheishe ou
dans les quartiers bourgeois de Tel Aviv
afin de savoir ce que peut apporter le
cinéma.
Inscrire une réalité dans l’esprit des gens
Que peut le cinéma contre l’occupation
des territoires palestiniens ? On serait
tenté de répondre que le cinéma n’a pas
forcément vocation politique. Mais aussi
qu’une caméra ne peut rien face à un
char israélien, que l’image ne vaincra
jamais un obus. Les réalisateurs et producteurs
qui se sont entretenus avec
Janine Halbreich Euvrard nous disent
pourtant le contraire. Si le cinéma ne
peut pas changer les gens il peut « secouer
leur suffisance » [1], il initie un mouvement.
Documentaires et fictions projettent des
approches différentes. Les premiers
décrivent des réalités médiatisées par le
regard du réalisateur ; les secondes
s’adressent davantage aux imaginaires.
Comme l’affirme le documentaliste
Samir Abdallah, co-réalisateur d’Ecrivains
des Frontières en 2002, « un film
permet d’inscrire une réalité dans la
tête des gens ». Cette réalité, c’est celle
que scrute Simone Bitton dans son film,
Mur, c’est celle de l’occupation et de
l’humiliation décrites dans Checkpoint
de Yoav Shamir, c’est celle de la Mouqata’a
encerclée par l’armée israélienne
montrée dans Siège de Samir Abdallah.
Pour Mai Masri, documentariste
palestinienne, « le cinéma est un vecteur
très puissant, il est un double de la
mémoire » et parlant du moment où les
Palestiniens ont pu contrôler leur propre
image elle ajoute : « Cela a donné plus
de force sur leur destinée. En cela réside
la puissance du cinéma. »
La nouvelle génération de cinéastes
palestiniens est aujourd’hui particulièrement
active, malgré des moyens techniques
et humains largement insuffisants.
Leur approche est différente de
celle de leurs prédécesseurs. Le rapport
de cette génération à l’espace et au temps
a changé. Sa vision des choses est conditionnée
par le rétrécissement graduel de
l’espace et du temps qu’entraîne l’occupation,
car elle est née et vit dans un
monde fragmenté par des barrières, entrecoupé
de barrages. « Pour forcer les
frontières fermées et accomplir ce qui
dans la réalité n’est pas possible », écrivent
Nurith Gertz et George Khleifi [2]
« le cinéma palestinien s’est tourné vers
le rêve, l’amour et l’imagination ; ces
éléments ont pour fonction de réunir
l’espace fracturé et de recoller l’identité
divisée. » C’est tout le sens de la
scène du film d’Elia Suleiman Intervention
Divine, dans laquelle un ballon
rose à l’effigie grossière de Yasser Arafat
s’en va flotter au dessus du poste de
contrôle israélien, puis de Jérusalem,
pour finalement se poser sur la mosquée
Al Aqsa.
Les symboles nationalistes traditionnels
des films de Michel Kleifi, considéré
comme le fondateur du cinéma palestinien,
sont perçus et utilisés de façon différente
par la jeune génération. Là où
Michel Kleifi reliait ces symboles « au
pays, au village, à la maison », les jeunes
réalisateurs « préfèrent se concentrer sur
un espace isolé pour en faire un symbole
de totalité. » Le cinéma d’Elia Suleiman
essaye de « construire une image
qui se situe au delà de toute définition
idéologique de ce que signifie être Palestinien,
loin de tous les stéréotypes. » [3]
Un cinéma de résistance
Le cinéma israélien commence à aborder
le conflit israélo-palestinien à la fin
des années 70. Ce cinéma politique, très
critique envers la politique colonialiste
israélienne, dominera les années 80 pour
évoluer au début des années 90 vers le
« documentaire de création » et une forme
de cinéma plus personnel.
Pour de nombreux réalisateurs israéliens
qu’a rencontrés Janine Halbreicht-
Euvrard, le cinéma est avant tout un acte
de résistance. Un acte de résistance contre
l’occupation israélienne des territoires
palestiniens. C’est le cas d’Anat Even
dans son film Asrot (Enchaînés) qui
pénètre l’intimité de l’occupation en
offrant une lecture féminine du conflit.
C’est aussi le cas de Checkpoint de Yoav
Shamir, de Private de l’Italien Saverio
Costanzo, de Mur de Simone Bitton ou
de Khirbet Khiza’a de Ram Loevy, dans
les années 70, qui met en scène le récit
d’un soldat israélien qui participe à
l’expulsion des habitants du village palestinien
de Khirber Khiza’a.
Le cinéma se fait, dans ce cas, acte de
résistance contre la domination du discours
militariste masculin dans la société israélienne.
Dans Ever Shot Anyone, Michal
Aviad montre la vie d’un camp de réservistes
à la frontière du Golan. A travers
ce documentaire, le spectateur pénètre
dans la culture militaire israélienne et
observe les difficultés de la réalisatrice
à imposer sa caméra, donc son autorité,
dans un milieu exclusivement masculin.
Le cinéma est un acte de résistance contre
« le rouleau compresseur sioniste » [4] qui
a écarté la langue et la culture d’origine
des nouveaux arrivants, principalement
les sépharades arabophones, les obligeant
à nier leur propre passé pour pouvoir
s’intégrer dans la société israélienne.
C’est ce que montre Nurith Aviv dans son
quatrième film, Misafa Lesafa.
Amos Gitai, probablement le réalisateur
israélien le plus célèbre et le plus récompensé,
questionne, dans ses films, les
notions de foyer, de territoire, de patrie,
qu’on retrouve dans le « cinéma national
héroïque israélien » [5]. Il cherche à
comprendre les processus de naissance
des mythes autour de ces notions. Pour
Amos Gitai, « le territoire n’est pas un
lieu de refuge et de construction d’identité
», tel qu’il est présenté dans le « foyer
national utopique inventé par le sionisme.
Le territoire n’est pas une position
de repli mais un lieu où on doit
affronter les dilemmes. »
Tous ceux à qui Janine Halbreicht-Euvrard
donne la parole dans ce livre veulent
croire au rôle du cinéma dans leur dimension
de lutte, de résistance et de dialogue.
Plus qu’aucun autre support le
cinéma est sûrement le moyen le plus
efficace pour amener et dénoncer la réalité
du conflit israélo-palestinien dans
chaque foyer. Oui, le cinéma a et aura toujours
un rôle à jouer. Le dernier mot
revient à Simone Bitton qui termine son
entretien avec Janine Halbreich Euvrard
par un « Vive le Cinéma, à bas les murs ! »
plein d’optimisme.
Maxime Guimberteau