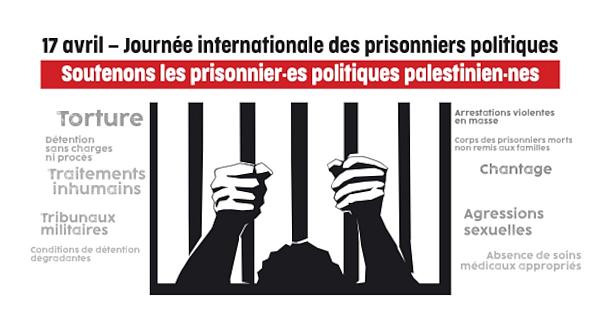Pouvez-vous présenter le système scolaire israélien ?
Y. B. A. : C’est un système séparé entre trois secteurs distincts : arabe, juif non religieux, juif religieux. Au sein des écoles juives religieuses, le programme diffère par la réduction du nombre d’heures de cours des matières profanes, et donc de l’histoire, au profit de l’enseignement religieux.
Comment l’histoire est-elle enseignée dans les écoles juives non religieuses ?
Y. B. A. : Les écoles religieuses mises à part, il faut reconnaître une cohérence lorsqu’on lit le programme officiel : aucune période n’est écartée. La chronologie débute à l’antiquité pour terminer sur des enjeux plus contemporains, centrée autour de l’histoire juive. Le problème réside dans la manière de développer les leçons en classe. Par exemple au lycée, les enseignants abordent l’installation de communautés juives en Palestine dans l’entre-deux-guerres, c’est-à-dire pendant les années 1920 et 1930. Une activité fait travailler les élèves autour de la déclaration Balfour, de 1917, qui reconnaît pour la première fois le droit aux populations juives de fonder un foyer national en Palestine. Ce travail vise à justifier la légitimité du projet sioniste et de la construction de l’État sur cette terre. La quasi-absence, dans le texte de Balfour, de considération pour les populations arabes, pourtant majoritaires, est instrumentalisée par le système scolaire pour ne parler des autochtones que comme une minorité vivant sur une terre essentiellement vide. Par ailleurs, cette « minorité » est essentiellement perçue comme un groupe religieux, n’ayant ni sentiment patriotique, ni identité nationale. Cette vision très orientaliste se retrouve dans de nombreux points du programme.
Les enseignants sont également invités à questionner l’origine de la déclaration Balfour. Si nous ne savons pas ce qui se passe lorsque la porte de la classe est fermée et que l’enseignant peut échanger avec ses élèves, les activités mises au programme écartent complètement les enjeux coloniaux ou impérialistes de la part des Britanniques. Balfour aurait simplement voulu être reconnaissant envers le mouvement sioniste qui aurait œuvré en faveur de son pays pendant la Première guerre mondiale.
Le même programme est-il imposé dans les écoles arabes ?
Y. B. A. : Les programmes ont des similitudes, mais avec l’ajout d’éléments tirés d’une histoire plus arabo-islamique, autour de Saladin par exemple. Concernant leur propre histoire, en tant que Palestiniens d’Israël, ils entendent parler d’eux sous l’ère ottomane puis réapparaissent en tant que citoyens israéliens. Que s’est-il passé entre-temps ?
Naturellement, l’école ne peut pas faire l’impasse sur 1948. L’enseignement de la première guerre israélo-arabe tourne autour de trois mythes, que les Nouveaux historiens israéliens ont pourtant battus en brèche depuis les années 1990. D’abord, l’idée d’un remake de David contre Goliath, où le jeune État d’Israël faisant face aux armées de plusieurs États. En réalité, dès le début de la guerre, les troupes sionistes peuvent compter sur au moins 40 000 soldats, tandis que les groupes armés palestiniens regroupaient, en tout et pour tout, 10 000 combattants mal entraînés et faiblement équipés. Lorsqu’en mai 1948 les pays arabes s’en mêlent, Israël bénéficie toujours, dans les faits, d’un rapport de force favorable de par son équipement militaire et ses ressources. Ensuite, les combattants juifs se seraient contentés de se défendre face aux offensives arabes : sauf que les troupes sionistes ont conquis bien plus de terre que ce que prévoyait le plan de partition de l’ONU, et pas seulement par des actions défensives, mais bien par des attaques, des expulsions et le dépeuplement de plus de 500 villages.
Enfin, les Palestiniens n’ont été expulsés qu’à la marge, la plupart d’entre eux auraient fui à l’appel de leurs dirigeants : ce qui est complètement faux, au moins 70 % des Palestiniens ont quitté leurs maisons en 1948 du fait de violence directe exercée à leur encontre. Rappelons que peu importe la manière dont les Palestiniens se sont retrouvés en exil, rien ne justifie qu’ils soient empêchés de retourner sur leur terre.
Pour mesurer la prégnance de ces mythes dans le récit national israélien, et les moyens mis en oeuvre pour les défendre, il faut jeter un œil à la page Wikipédia en hébreu de la guerre de 1948, c’est stupéfiant.
Comment les enseignants israéliens peuvent ils accepter de transmettre ces mensonges historiques à leurs élèves, alors même que les historiens ont depuis des décennies remis en question le récit national sioniste ?
Y. B. A. : L’ignorance ? La question mérite d’être posée : connaissent ils l’ensemble de ces études critiques ? Pour certains, ce doit aussi être une part de crainte face aux réactions de leurs élèves ou des familles.
Ce qui est étrange, c’est qu’au moment du vote de la « Loi Nakba » en 2011, qui était en fait un amendement au budget d’État visant à retirer les subventions aux associations participant à des commémorations le jour de la fête nationale, le terme est entré dans le langage courant.
Dans de nombreux médias, des débats ont eu lieu sur l’histoire de 1948 et ce que signifie « Nakba » pour les Palestiniens. Il me semble que cette séquence politique a permis de fissurer le récit national, dès lors qu’un terme censé être proscrit se normalise auprès du grand public.
Cependant, la réponse des autorités a été de dire : la Nakba est une réalité, mais elle ne s’est pas passée comme les Palestiniens le prétendent et s’ils avaient pu, ils nous auraient expulsés. Voire : les troupes juives ont été contraintes d’agir ainsi compte tenu du contexte de l’époque et pour créer l’État juif, si c’était à refaire on le referait. À bien des égards, je pense que les enseignants ont intériorisé ce discours, ils l’ont accepté, de force ou de gré.
Dès lors, qu’est-ce qu’un enfant juif israélien apprend de l’histoire des Palestiniens pendant son cursus scolaire ?
Y. B. A. : Un narratif schizophrénique. On ne parle pas officiellement des Palestiniens, mais ils sont en fait omniprésents : la colonisation sioniste se serait faite sur une terre vide, mais les populations juives auraient fait face à des révoltes arabes. Si la terre est vide et habitée uniquement par une petite minorité religieuse, qui sont ces révoltés ?
Et surtout, pourquoi se révoltent-ils ?
Que fait Zochrot pour changer cela ?
Y. B. A. : Contrairement à certaines ONG, comme Breaking the Silence, qui ont pu intervenir dans des écoles, notre organisation est persona non grata auprès du ministère de l’Éducation car considérée comme trop radicale.
À côté de nos activités traditionnelles d’information et de mise en patrimoine des ruines des villages palestiniens de 1948, nous développons des outils destinés aux enseignants pour corriger leur manière de parler de la Nakba. Un dispositif de formation pour les professeurs a aussi été mis en place, autour d’ateliers thématiques.
Face à des enseignants qui nous expliquent que le programme est trop chargé et qu’ils n’ont pas le temps d’aborder toutes ces questions, nous avons mis en place un guide « Comment dit-on Nakba en hébreu ? », qui leur propose de modifier certaines de leurs activités pour nourrir la réflexion. Par exemple, sur Balfour ou les violences arabes des années 1930, nous proposons l’étude de certains documents, l’ajout de certaines questions à des activités proposées par le programme.
Récemment, nous avons mis en place le même type de guide mais destiné aux enseignants en littérature pour discuter du parcours de certains auteurs, prendre le temps de s’arrêter sur des allusions à la population arabe dans des œuvres étudiées en classe. Nous essayons d’introduire des questionnements là où d’habitude les enseignants ont tendance à mettre ces points de côté pour éviter d’entrer dans des problématiques conflictuelles. Sauf qu’en agissant ainsi, les écoles ne poussent pas à l’esprit critique ou à la formation de culture politique chez les élèves, bien au contraire.
Propos recueillis par Thomas Vescovi
>> Consulter et télécharger l’ensemble du n°81 de la Revue PalSol