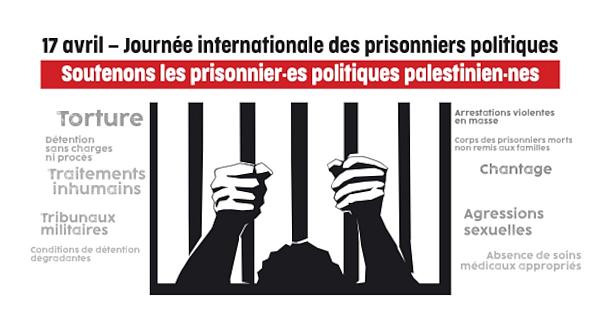Un voyage en Palestine constitue à chaque fois un objectif politique et une épreuve psychologique complexe. On s’y rend avec au moins une triple intention :
– pénétrer avec empathie dans la réalité quotidienne d’un peuple militairement occupé et humilié ;
– écouter au plus près la société et les forces politiques qui mènent le combat encore inachevé de libération nationale ;
– tenter d’en tirer des enseignements précieux pour une solidarité plus efficace.
Tel est le conditionnement d’ensemble, visible et invisible, qui préside à nos contacts (militants d’ONG, responsables politiques, représentants de l’ANP). Le fil directeur qui préside à toute discussion c’est : comment résister à l’occupation ? De ce point de vue, l’entretien initial avec Yasser Arafat - encore sous le coup de l’assassinat du Cheikh Yassine mais aussi de l’échec du sommet arabe prévu à Tunis le 30 mars - a été l’occasion pour lui d’exprimer son amertume vis-à-vis de la communauté internationale qui n’a jamais tenu ses engagements. Il nous rappelle à nous Européens le rôle décisif de l’Europe pour l’avenir proche et lointain.
L’impasse dans laquelle se trouve la stratégie politico-diplomatique, éventuellement articulée à l’Intifada, apparaît à cet égard pathétique et pose au mouvement de libération des problèmes redoutables.
On se contentera ici de répertorier les problèmes que se posent les Palestiniens tels qu’ils sont ressortis des différents entretiens que nous avons pu avoir avec les nombreux responsables représentant une large part de l’éventail associatif et politique palestinien et les militants du camp de la paix israélien dans ses différentes composantes : que faire aujourd’hui, à cette étape, d’une lutte si longue et si dure qui, après avoir semblé être sur la voie d’une solution politique, semble maintenant au bord d’une nouvelle Nakba ? Quels rapports entre stratégie militaire et stratégie politique ? Quelle place pour les méthodes non violentes et quelle place pour les formes de résistance armée ? Quelle articulation entre négociations et résistance ?
De ce kaléidoscope d’interrogations et d’analyses, on peut tirer plusieurs constats. Le premier, c’est toujours la capacité remarquable de résistance de la société civile qui s’organise pour ses besoins vitaux (santé, éducation, nourriture). Le second, c’est la capacité du système politique palestinien de refuser d’entrer dans une logique de guerre civile, comme l’escomptent depuis longtemps nombre d’Israéliens. Le troisième, c’est la grande amertume à l’égard de l’attitude des Etats, qu’ils soient arabes ou occidentaux, avec une nuance porteuse d’espérance sur le rôle, potentiel ou réel, de l’Union européenne. Le quatrième c’est l’importance politico-symbolique de la solidarité active de militants israéliens.
Résistance civile ou lutte armée ?
Le cinquième, ce sont les différences dans le choix des méthodes de lutte. D’un côté le mouvement islamique (que nous n’avons pas rencontré) pour lequel le moyen principal de résistance reste la lutte armée dans les territoires occupés mais aussi des actions terroristes en Israël. Ce courant est en partie rejoint par certains groupes du Fatah. De l’autre, il y a une majorité du Fatah - celle proche de Marwan Barghouti - et la gauche « laïque » regroupée derrière Mustapha Barghouti, qui refusent les attentats contre les civils et qui proposent d’abord une résistance civile de masse non violente avec, pour partie d’entre eux, des formes de résistance armée visant les soldats occupants et les colons armés. Enfin il y a, parmi les partisans de l’initiative de Genève, elle-même l’objet d’un réel débat, ceux qui comptent avant tout, sans forcément exclure certaines formes de lutte civile, sur les mobilisations politico-diplomatiques.
Finalement se pose encore la question du rapport entre résistance, projet de libération nationale et recherche obstinée d’une négociation politique avec Israël en s’appuyant sur la communauté internationale (Etats et opinion publique). Quelles conséquences en tirer pour le mouvement de solidarité ? Accompagnant le développement renforcé des différentes formes de solidarité politique et matérielle en relation directe avec les forces qui, sur place, s’organisent pour survivre et résister, il faut construire un mouvement large à l’échelle européenne visant à contraindre l’Europe à intervenir par tous les moyens à sa disposition.