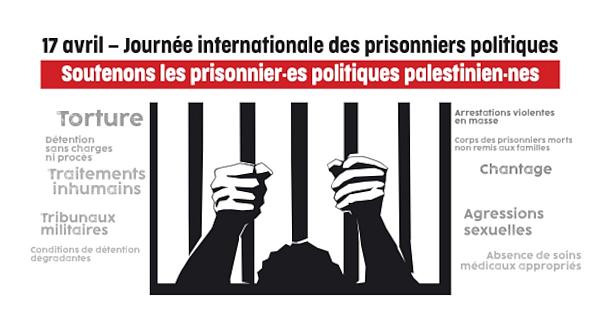Les autorités les qualifient d’« Arabes israéliens ». Eux-mêmes se présentent en général comme des « Palestiniens d’Israël ». Au-delà de la polémique sémantique, ces deux formules reflètent un double processus contradictoire, qui s’est développé au cours des 75 dernières années : l’« israélisation » de la population arabe et, en même temps, sa « palestinisation ». Le premier reflète les acquis démocratiques de cette population, qui jouit notamment du droit de vote. Le second confirme qu’elle reste soumise à une forme d’apartheid qui, pour être moins brutale qu’en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, n’en comporte pas moins des discriminations légales et de fait.
Israël compte aujourd’hui 1 957 270 Arabes, soit 21,1 % de la population israélienne. Dont 362 000 « résidents » de Jérusalem-Est, qui n’ont pas pris la citoyenneté israélienne, contrairement aux 1 595 300 Arabes citoyens israéliens (soit 17,2 % de la population). La réussite sociale de quelques-uns et la constitution d’une classe moyenne ne sauraient cacher que 45,3 % de familles arabes (et 57,8 % d’enfants) vivent sous le seuil de pauvreté.
Leur statut pose un premier problème : l’État d’Israël distingue la « nationalité » (juive, arabe, druze, etc.) de la « citoyenneté » Même si les mentions nationales ont fini par disparaître de la carte d’identité, l’ONG Adalah recense au moins 65 lois qui structurent l’infériorité de la « nationalité » arabe en Israël, et ce dans tous les domaines de la vie : droit de citoyenneté, participation politique, droits fonciers et au logement, accès à l’éducation, droits culturels et linguistiques, droit à une procédure régulière pendant la détention… Le second problème tient à la loi du 19 juillet 2018, dite « Loi État-nation du peuple juif ». Car cette loi, puisque fondamentale, grave l’apartheid dans le marbre constitutionnel. Ainsi son article 1 stipule que « Seul le peuple juif a droit à l’autodétermination nationale en Israël ». Son article 4 réserve le statut de « langue d’État » au seul hébreu, alors que l’arabe le partageait avec lui jusque-là. Cette législation contredit donc la Déclaration d’Indépendance d’Israël, qui promettait notamment : le nouvel État « assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ».
L’enjeu foncier
Lorsque l’ONU adopte, le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine en deux États, l’un juif et l’autre arabe, elle recense 608 000 Juifs et 1 237 000 Arabes. L’État juif, pour sa part, en comprendrait respectivement 498 000 et 407 000. Ces chiffres suffisent à expliquer pourquoi, si les dirigeants palestiniens et arabes refusaient le principe de la partition, David Ben Gourion et la direction sioniste étaient bien décidés à augmenter le territoire de leur État et à en expulser le plus possible de Palestiniens. De fait, au terme des armistices de 1949, seul l’État juif a vu le jour sur 78 % du mandat britannique (au lieu des 56 % prévus par l’ONU). L’épuration ethnique s’est donc accompagnée d’une spoliation massive : les nouveaux occupants ont détruit ou judaïsé plus de 500 villages palestiniens et mis la main – selon un bilan gouvernemental – sur 73 000 pièces d’habitation dans des maisons abandonnées, 7 800 boutiques, ateliers et entrepôts et surtout 300 000 hectares de terres.
Entre la théorie et la pratique, les affirmations de la Déclaration d’indépendance n’ont pas empêché l’application aux quelque 150 000 Arabes devenus citoyens israéliens d’un « régime militaire » d’exception, issu principalement des lois d’urgence britanniques. La levée de ce régime en 1966 n’a pas entraîné la suppression de toutes les dispositions légales ou réglementaires. La plus flagrante demeure la violation structurelle du droit des citoyens palestiniens à la terre.
Dès 1950, la loi rétroactive dite des « absents » permet aux autorités israéliennes d’étendre sans cesse leur mainmise en confisquant les terres arabes (et non juives) aux Palestiniens qui n’étaient pas formellement chez eux à la naissance d’Israël. Le Fonds national juif prend possession de 93 % des terres. Dix ans plus tard, face à la menace de voir des notables arabes racheter leurs propriétés spoliées, les autorités israéliennes votent la loi fondamentale sur « Les Terres d’Israël », déclarées comme inaliénables aux « non-Juifs ». Ainsi, les Juifs, à la veille du plan de partage de 1947, avaient acquis moins de 7 % des terres de la Palestine sous mandat britannique ; soixante-quinze ans plus tard, les Arabes israéliens ne détiennent plus que 3 % des terres d’Israël (contre 48 % en 1948) [1].
Un processus colonial qui se poursuit sous d’autres formes. Certaines municipalités juives, bien mieux équipées, font face aux demandes croissantes d’installation de familles arabes issues d’une classe moyenne qui s’est développée depuis la fin des années 1980. En 2011, les autorités israéliennes poussent la Knesset à voter une loi encadrant la formation de « comités d’admission ». Dans les villes moyennes, ou les petites communautés juives, ces structures peuvent être mises en place pour décider si un nouveau loueur ou acheteur est « convenable » (sic). Il s’agit également d’empêcher la justice israélienne de donner raison aux Arabes qui intentent des procès aux localités leur ayant refusé la location ou l’achat d’un bien.
La ville juive de Carmiel, située dans le nord d’Israël, constitue un cas emblématique. Elle compte 47 000 habitants, dont 2 500 Arabes. Ces derniers sont issus de quelques dizaines de familles de la classe moyenne. Le système scolaire israélien étant ségrégué, les écoliers de ces familles sont chaque jour transportés vers les établissements scolaires en langue arabe des villes voisines. Les familles ont demandé l’installation d’une ligne de bus ou le remboursement des frais de transport par la municipalité. La justice a fini en 2020 par donner raison au maire qui refuse d’engager ces frais, au motif que cela pourrait « modifier l’équilibre démographique de la localité et porter atteinte à son identité ». En d’autres termes : ne plus être une ville juive.
Contrôler et fragmenter
Des dizaines d’exemples peuvent être mentionnés pour étayer la réalité du régime d’apartheid, définit comme « des actes inhumains […] commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime. » Et ce même si l’expression onusienne de « groupe racial » ne semble évidemment pas appropriée pour qualifier les Juifs israéliens et a fortiori les Juifs en général. Depuis 2002, et plus particulièrement après le durcissement de 2021, la loi sur la citoyenneté israélienne rend impossible le regroupement familial pour les Arabes [2]. Et ce alors même qu’un individu de confession juive peut, par le biais de la « Loi au retour », immigrer en Israël et y obtenir dans des délais brefs la totalité des droits et des privilèges en appartenant au groupe national juif.
En politique, l’engagement des Arabes israéliens fait aussi l’objet d’un encadrement et d’une surveillance symptomatique d’un régime d’oppression. Si au sein du groupe national juif, les formes d’extrémismes les plus abjectes peuvent librement s’exprimer, être représentées à la Knesset, voire désormais participer au gouvernement, un Palestinien peut se voir retirer son éligibilité s’il remet en cause le droit à l’existence d’Israël au profit d’une autre solution étatique.
Enfin, l’inquiétude demeure autour de la constitution d’une prétendue « garde nationale » aux ordres du ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir. Les débats qui entourent la constitution de cette milice, prévue pour 2024, pointent clairement les Arabes israéliens comme premières cibles.
Se satisfaire de dénoncer une « simple » situation de discrimination pour délégitimer les rapports des ONG ne tient pas face aux faits. Les discriminations dont sont victimes les Arabes en Israël forment la partie d’un tout qui s’appréhende comme un régime d’apartheid de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain parce qu’il permet, à des degrés divers et avec des outils différents, de contrôler, dominer, exproprier et fragmenter le peuple palestinien.
Thomas Vescovi, enseignant et historien, auteur de L’Échec d’une utopie. Histoire des gauches en Israël
(La Découverte, Paris, 2021) ;
Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de Israël : Naissance d’un État (L’Harmattan, Paris, 2022).