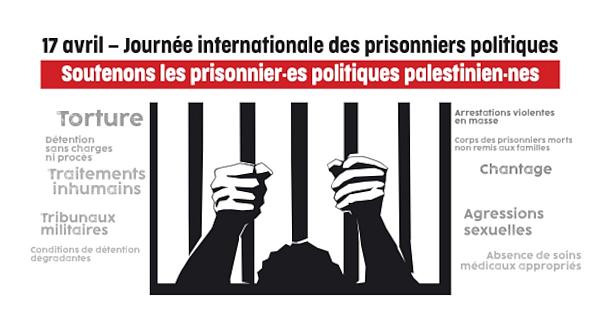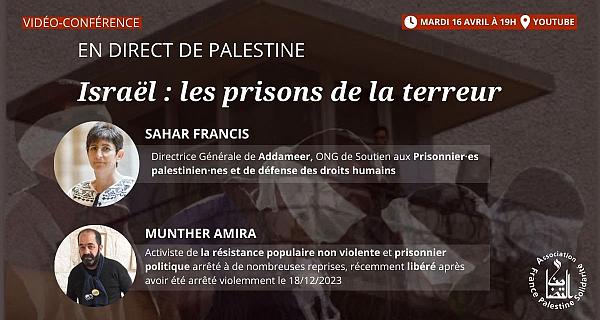Conférence de jeudi dernier sur l’histoire de la Palestine avec Madame Mansour-Mérien.
Toutes les vidéos de l’AFPS Sciences Po à l’adresse http://www.youtube.com/channel/UC_F...
Histoire de la question palestinienne - Conférence de Sandrine Mansour Mérien - Sciences Po 14/11/2013
Une conférence introductive nous a paru nécessaire avant de poursuivre sur des conférences plus spécifiques (solution à un État, situation des prisonniers, la question des réfugiés…). Le conflit nous parait souvent lointain, et cela engendre un certain désintérêt.
Sandrine Mansour-Mérien est une historienne qui a notamment publié L’histoire occultée des Palestiniens (1947-1953). Elle place la Nakba au cœur du conflit.
C’est un véritable challenge d’expliquer cent ans d’Histoire en une heure. Cependant, cette Histoire est importante car elle est souvent méconnue. Par ailleurs, les archives s’ouvrent petit-à-petit en Israël, aux États-Unis et en France notamment. Il n’y avait eu qu’une version des faits jusqu’à présent ; celle d’Israël qui justifiait ses actions. Cette version a été reprise par la plupart des pays occidentaux en raison de leur culpabilité quant à leur complicité pendant l’Holocauste. La voix des Palestiniens est occultée. Dans les manuels scolaires, on étudie le conflit à partir de 1948 : la guerre est présentée comme le premier événement, qui créé une population de réfugiés. Cependant, le conflit et le projet sioniste sont bien antérieurs à cela. Ce projet sioniste prend en compte les enjeux et la situation initiaux : la population palestinienne est très attachée à la terre, étant en majorité paysanne ; et ne se laissera donc pas faire.
Lorsque le projet est fondé à la fin du XIXème siècle, c’est un mouvement minoritaire mais qui a une vision futuriste (lié aux mouvements européens nationalistes de l’époque avec une dominance coloniale). Au départ, les sionistes n’ont pas uniquement la Palestine en tête mais aussi l’Argentine et l’Ouganda. Ils vont sur place, effectuent des études agricoles et économiques. L’Argentine est très propice au projet sioniste. Cependant, le mouvement ne prend pas d’essor au départ.
Alors qu’il est laïc au départ, certains membres religieux proposent d’utiliser comme base les textes religieux afin de rassembler tous les Juifs. Le Judaïsme est en perte de vitesse à l’époque : les pratiques sont moins respectées. Le choix de la Palestine comme terre juive permet d’obtenir le soutien de l’Angleterre. L’Empire Ottoman est alors en déliquescence. Le mouvement sioniste demande aux Britanniques à installer son projet en Palestine. En 1944, les Américains ferment leurs frontières aux émigrés juifs car ces derniers arrivent avec des idées communistes. Cela détermine le succès du projet sioniste. Des petites colonies, ‘kibboutz’, sont tout d’abord implantées avec les financements de Juifs fortunés comme Rothschild. Puis, un projet de lobbying prend le relais.
L’année 1917 est marquée par la déclaration Balfour. Balfour lui-même n’est pas sioniste et est plutôt antisémite. Il adhère au projet pour se débarrasser des Juifs en Europe. Il devient le porte-parole des sionistes auprès du gouvernement britannique mais ce sont les sionistes qui rédigent la déclaration. Ces derniers envoient un projet aux Français et aux Anglais dans lequel ils réclament la moitié du Sinaï, une partie de l’Arabie Saoudite, le Liban, la Transjordanie, la Syrie et la Palestine. Les Anglais et les Français sont au départ tous deux favorables au projet. Les Juifs achètent petit-à-petit des terres, au Liban et en Syrie surtout.
Les Palestiniens réalisent ce qui est en train de se passer mais ils ne sont pas écoutés. Ils écrivent au sultan et T. Herzl le rassure en lui expliquant que les Juifs n’apportent que civilisation et modernité. Les Français ne font pas de distinction entre les populations arabes et les sionistes se servent de leurs techniques coloniales pour avancer et ne pas faire écouter les voix palestiniennes. Les Anglais ont promis aux Palestiniens l’indépendance de leur État. Cependant, contrairement aux autres pays du Levant, le mandat de la Palestine ne fait référence qu’à la déclaration Balfour.
Les sionistes prétendent vouloir collaborer avec la population locale mais en réalité, tous les projets sur place sont dirigés pour les Juifs. Les magasins et les terres achetés sont destinés aux Juifs. Les Palestiniens s’en rendent compte et s’organisent. En plus de manifestations, ils créent en 1918 un comité nommé Comité islamo-chrétien. Le comité porte la voix de la population locale et rédige des lettres à la chancellerie. Balfour se rend sur place pour la première fois après la déclaration et ne parle pas à la population locale. Il y a un double discours de la part des britanniques. Le discours adressé aux Palestiniens est seulement oral, et donc ne les engage pas officiellement. La Haganah est créée en 1920 afin de protéger les colonies. Les milices Irgoun et Stan Gan, plus violentes, sont fondées pour s’opposer aux Anglais et à la population locale. Les Palestiniens refusent de vendre les terres (contrairement au Liban).
Les sionistes utilisent des intermédiaires jusqu’à la fin des années 40 où des régulations sur le nombre d’émigrés juifs sont imposés par les Anglais. Les Palestiniens manifestent, écrivent ; les femmes s’organisent aussi. Très tôt, elles s’organisent sur le volet nationaliste mais aussi pour les droits des femmes. La Palestine est avant-gardiste sur cette dernière question. Les premiers appels au boycott datent de 1919-1920 quand les Palestiniens se rendent compte qu’ils sont licenciés par leurs patrons juifs et remplacés par des employés juifs. Cela correspond à une période tendue en Europe et par conséquent, au Moyen-Orient.
Entre 1936 et 1937, les Palestiniens organisent une grande révolte, due aux conditions dans le monde du travail (syndicat, conditions de travail..). La révolte est accompagnée d’une grande grève générale avec à sa tête le comité islamo-chrétien. Plusieurs partis naissent à ce moment. C’est une période très difficile car les Anglais sont occupés en Europe et disposent donc de moins de moyens. La situation économique est critique, surtout au Moyen-Orient. Aussi, les Anglais vont mater extrêmement violemment la révolte palestinienne qui devient un mouvement arabe. Entre 1936 et 1939, la répression continue alors que la grève a cessé. L’élite politique est envoyée en exil et la population est complètement désarmée. Beaucoup sont emprisonnés et certains condamnés à mort. Dans le même temps, les avis sont partagés chez les Anglais. Sur place, certains décrient l’injustice et en 1937, la commission Peel est créée pour trouver une solution au problème.
La commission Peel met en avant le projet que leur soumettent les sionistes : le partage de la Palestine. C’est un premier pas pour les sionistes, qui sont conscients qu’ils ne peuvent pas obtenir le Liban et la Syrie de suite. Bien sûr, les Palestiniens refusent ce projet et les sionistes feintent être contre. Les Anglais publient alors le Livre Blanc qui impose une régulation sur l’émigration juive et bloque leur date de départ afin de trouver une solution stable. Pour les sionistes, la position anglaise n’est plus du tout acceptable. Plusieurs bâtiments britanniques sont détruits et des officiers anglais sont tués par les milices. Les sionistes sont déjà bien organisés : il y a trois milices et un service des renseignements. Un laboratoire est aussi créé pour une utilisation future. En effet, à partir de 1940, Ben Gourion recrute trois chercheurs européens pour élaborer des armes chimiques et reconstituer la typhoïde qu’Israël utilise pour empoisonner l’eau.
En 1940, la situation des Anglais se détériore et les attentats en Palestine se multiplient. Entre 1944 et 1945, ils décident de rendre le mandat plus tôt que prévu mais hésite entre le partage de la Palestine ou la création d’une fédération. L’ONU vient d’être créée et son premier dossier est celui de la Palestine. Les palestiniens n’ont plus les moyens de s’opposer entre l’exil et la désunion créée par le jeu des Anglais (diviser pour mieux régner). En 1947, les sionistes ont demandé les régions agricoles les plus riches. Lors de la résolution de l’ONU quant au partage de la Palestine, les résultats étaient prévus comme opposés au partage. Cependant, les Américains demandent d’ajourner le vote de quelques heures et influencent les petits pays (menaces, promesses…). Le partage est finalement accepté. Plus de la moitié du territoire revient aux Juifs.
Entre 1947 et 1953, les sionistes évacuent la population : il faut se débarrasser de la population. En mai 1948, la guerre fait partie de cette logique. Israël bénéficie de l’aval de la Jordanie pour le partage (cette dernière veut récupérer une part de la Palestine aussi). Les ¾ des palestiniens réfugiés le deviennent alors que les Anglais sont encore sur place (et ont le devoir de protéger la population locale). Des généraux américains auraient aussi participé à la guerre aux côtés des sionistes. La guerre de 1948 permet à l’État d’Israël d’augmenter à 78% la surface du territoire (le long de ce qu’on appelle aujourd’hui la « ligne verte »).
En 1948, au lendemain de la guerre, le médiateur Bernadotte est envoyé sur place. Il se rend compte que la situation est complètement différente de ce qu’on lui a décrit. Il envoie un rapport soulignant qu’il faut reconnaitre le droit au retour des réfugiés (le mot réfugié est cité 13 fois dans son rapport) et qu’il faut régler la question de Jérusalem. Le comte Bernadotte est assassiné le lendemain de l’envoi de son rapport. Celui-ci sera cependant utilisé lors de la rédaction de la résolution 59. Au delà de la question palestinienne, du droit au retour, de la compensation et de Jérusalem (entité internationale), cette résolution reprend les bases de la déclaration des droits de l’Homme. Elle a été votée plus de cent fois et est l’une des plus anciennes résolutions de l’ONU mais elle n’a jamais été appliquée. En 1953, Israël arrête d’expulser massivement la population locale en réponse au boum de la photo de presse. A l’ONU, les occidentaux demandent aux Israéliens de stopper leur action car la communauté internationale commence à poser des questions.
Israël décide d’attaquer en juin 1967. En quelques heures, elle multiplie par quatre son territoire (acquisition du Golan et du Sinaï). Pendant ce temps, les Palestiniens se sont organisés. Ils ne sont pas autorisés à venir à l’ONU et ils nomment des ambassadeurs dans les pays arabes pour accéder à la tribune. Mais ce n’est pas suffisant. Ils ne sont pas écoutés et les résolutions ne sont pas appliquées. Alors que les Palestiniens sont acculés, Leila Khaled détourne des avions. L’OLP est créée quatre ans plus tôt mais, ils ne sont pas représentés au niveau officiel. C’est parce qu’il y a cet électrochoc des détournements d’avion que l’opinion internationale réalise l’ampleur de la situation. C’est la population réfugiée la plus grande dans le monde. En 1974, Arafat est autorisé à parler à la tribune à l’ONU. Cela marque la reconnaissance palestinienne en tant que telle.
En même temps, jusqu’à 1987, les choses s’aggravent. En 1967, les israéliens commencent la colonisation. Il y a eu un débat interne en Israël de quelques heures entre les tenants de la colonisation immédiate et ceux qui préféraient attendre l’établissement d’un projet de long terme. On commence à raser le quartier des maghrébins à Jérusalem à côté du mur des lamentations. En 1975, la guerre civile éclate au Liban ; une guerre dont les Palestiniens seraient à l’origine. Ils ne sont pas devenus Libanais et Syriens, et ne sont pas seulement des arabes comme le pensaient les Occidentaux. On voit dans les archives jusqu’à 1982 que l’Occident est pris dans ses propres contradictions. Les Français souhaitent traiter avec Arafat. Dans le même temps, les États-Unis laissent faire les massacres à Sabra et Chatila alors qu’Arafat les avait prévenus.
Quand éclate la première intifada, cela fait vingt ans que la colonisation se développe, aggravant la situation économique et politique des Palestiniens. Ces derniers continuent à payer des taxes à Israël alors qu’elle ne fait rien pour eux. La population explose contre la colonisation israélienne et contre l’immobilisme des autres pays. La Jordanie décide de laisser court à la détermination palestinienne. La première intifada marque un tournant : c’est la première fois qu’on parle des Palestiniens en tant que tels et non comme des Libanais, Jordaniens, Syriens ou terroristes. On voit que la population est désarmée, leurs seules armes étant des pierres, et on réalise qu’ils ont des enfants. C’est un tournant psychologique qui permet aux Palestiniens de se lancer dans toutes les négociations possibles. Leur position bascule du rejet à un état de reconnaissance – on reconnait qu’Israël existe sur 78% du territoire mais on exige que les 22% restant soient sous contrôle complet des Palestiniens. En 1982, l’Arabie Saoudite s’engage dans la même logique en réclamant des terres contre la paix (reconnaissance d’Israël).
Un nouvel élément vient bouleverser la situation : l’occupation de l’Irak par le Koweït. La communauté internationale se révolte, les États-Unis s’écrient qu’on ne peut pas occuper un pays de cette manière. Les Palestiniens demandent pourquoi ils ne méritent pas le même traitement. L’Arabie Saoudite refuse de participer à la résolution des événements si rien n’est fait pour la Palestine. La conférence de Madrid, qui mènera aux accords d’Oslo, est alors organisée. Les cartes sont faussées : les Israéliens sont obligés de venir mais ils ont imposé un agenda. L’ONU ne sera pas médiatrice, les Américains décideront. Aucune référence à la résolution 194 ne sera faite et les Palestiniens doivent se présenter sous la tutelle de la Jordanie. Arafat pense que les accords signés ne représentent qu’une première étape. On découpe les territoires en trois zones et la question des réfugiés, de l’eau, de Jérusalem n’est pas traitée. Pour les Israéliens, l’accord est définitif et permet d’imposer son contrôle des frontières, la mise en place de checkpoint et le renforcement de la colonisation.
Rabin est présenté comme celui qui pourrait faire avancer le projet de paix mais il est assassiné. On ne sait pas s’il aurait vraiment changé les choses. Il avait en effet amorcé une dynamique pacifique mais ce n’est pas pour autant qu’il aurait été au bout d’une reconnaissance d’un État palestinien.
Les accords d’Oslo montrent vite leurs limites. Arafat a joué le jeu, et il pensait obtenir plus. Cependant, les Israéliens ne veulent plus entendre parler de revendications de la part des Palestiniens. Avec l’éclatement de la seconde Intifada (orchestrée une nouvelle fois par les Israéliens), ils justifient la création du mur qui est un vieux projet israélien. En réalité, la sécurité n’est pas la raison du mur puisqu’il n’y a pas de réel contrôle par exemple entre la colonie French Hill et Shu’fat (Jérusalem Est). Les Israéliens parviennent à assoir leur emprise territoriale, déloger et recentrer les Palestiniens tout en s’accaparant les ressources en eau. Leur projet d’un contrôle complet du territoire se met en place. Aujourd’hui, l’armée israélienne joue le rôle du gardien de l’occupation et le fait efficacement. L’économie palestinienne n’est pas viable puisque toutes les sorties sont contrôlées, et qu’il n’y a pas d’aéroport. Les Palestiniens ne peuvent pas vivre sans perfusions internationales.
Parce que les membres de l’ONU n’osent pas faire imposer les questions politiques à Israël, ils créent une perspective économique : UNRWA. Les accords d’Oslo sont aussi un projet économique. Le seul agenda que l‘on propose aujourd’hui, la seule chose à laquelle on peut s’accrocher, c’est l’arrêt des financements par l’Europe de projets israéliens implantés en Palestine. Or, une intervention politique est nécessaire pour faire accepter à Israël le droit international. La population israélienne est composée aujourd’hui à 20% d’arabes. C’est le taux maximum que Ben Gourion avait accepté dans les années 30. Le regroupement familial est très difficile, les places à l’université sont limitées pour les arabes, les taux dans les banques sont différents ; sans compter que la Nakba ne peut pas être enseignée dans les écoles arabes en Israël.
Questions
Pourquoi l’Occident ne traite que des questions économiques et non politiques ?
C’est une réelle question. L’Europe finance l’occupation en aidant les Palestiniens. Tout le monde accepte cette réalité et le coût ne fait qu’augmenter. L’aéroport Gaza a été détruit par Israël alors qu’il a été financé par les impôts européens. Ce conflit détermine les tensions dans le monde. On doit condamner au niveau politique mais il n’y a pas de volontés politiques. La France ne devrait pas écouter la censure et le lobby mais elle n’a pas de politique à moyen et long terme. Récemment, les ambassadeurs français arabophones ont été envoyés en dehors de la zone… Aux États-Unis, AIPAC est un lobby juif qui a voix au chapitre pour les élections présidentielles américaines et pour ce qui est décidé à la Maison blanche. J Street est un nouveau lobby sioniste qui est favorable à un État palestinien mais qui n’est pas encore assez puissant. L’Europe, quant à elle, n’a pas de politique étrangère commune. On voit aussi qu’elle n’a pas d’avis sur la Syrie, Tunisie, Egypte et se laisse dépasser par des pays émergents qui jouent un réel rôle.
Quelle est, au cours du conflit, la position de la France sur la question palestinienne ?
La France est présente en Palestine à travers ses institutions religieuses, ses hôpitaux… Certes, ce sont les Anglais qui détiennent le mandat mais la France garde un rôle en tant que puissance chrétienne. Les Français sont des témoins et sont donc des éléments incontournables. Les sionistes ne respectent pas beaucoup de bâtiments religieux : jusqu’à quand les français vont accepter sans réagir ? Le Vatican essaie de négocier les taxes sur les bâtiments religieux. La France soutenait au départ le sionisme, puis elle se place en retrait depuis. Les États-Unis ont influencé son vote à l’ONU sur la question du partage. En échange de cela, le Conseil à Jérusalem est sous contrôle français en théorie. Cependant, les Anglais, les Américains et Israël décident de partager la ville en deux et la France se retrouve encore en retrait. Les années 60 marquent la réactivation du soutien français au projet sioniste, notamment à travers le projet nucléaire. France reste cependant prudente car elle est présente dans le Moyen-Orient, au Liban. Elle surveille notamment les mouvements palestiniens qui servaient d’exemple en Algérie.
Comment mettre Israël devant la table des négociations ?
Il faut qu’il y ait un tiers dans tout conflit. On ne laisse pas le vainqueur et le vaincu seul. Palestine exige la présence de ce tiers mais c’est le seul pays dans le monde à qui cela leur est refusé. Personne ne veut imposer le droit international à Israël. Or, la question de l’eau, droits humains, OGM, frontières, prisons…. est bafouée et peut être bafouée dans les autres pays aussi. Il faut faire intervenir des délégations (quand ils voient la situation sur place, ils comprennent qu’il y a un problème). Par ailleurs, le boycott est aussi une solution. Les Palestiniens n’ont pas les moyens financiers pour faire face à Israël mais ils ont développé une technique de résistance non-violente. Deux villages palestiniens : Nabi Saleh (700 habitants) et Beit Omar, offre une formation à la population sur comment réagir sans utiliser la violence. Elle fait face à des chiens, à des colons.
Quelle est la place qu’occupe la religion dans le conflit ?
Ce n’est pas un conflit religieux mais territorial. Les Israéliens veulent en faire un conflit religieux car c’est le discours sioniste original. La preuve que ce n’est pas un conflit musulman/juif est que les Chrétiens ont aussi été expulsés. Ce qui intéressant, c’est que depuis 1967, les Israéliens étudie la Bible et tentent sur le terrain de créer des liens en redonnant des noms bibliques ou en les hébraïsant. Ils effacent les traces archéologiques pour ne garder que celles qui corroborent le récit sioniste. Dans les manuels scolaires français, on invoque la justification biblique d’un État israélien comme étant véridique. Depuis six ans, Israël creuse le sous sol de la mosquée Al Aqsa. Au prochain tremblement de terre, elle s’effondrera et le Temple sera surement construit.
Pourquoi avoir omis le rôle joué par les pays arabes ?
Les pays arabes ont joué un rôle important mais ils étaient aussi en pleine indépendance. Par ailleurs les gouvernements arabes ne sont pas unis et cela se renforce avec la mise en place de dictatures à la tête de la plupart des états arabes. Dans ce contexte, l’élément palestinien est perturbateur car il demande un État laïc et démocratique. A part en 1973, lors de la guerre de Yom Kippour, les pays arabes n’ont pas pris d’initiative. Ils ne sont ni intervenus pendant les Intifadas, ni en 2009 à Gaza. De manière générale, il y a une instrumentalisation de l’Histoire palestinienne à des fins personnelles dans les pays arabes.
Comment font les villages qui s’organisent en résistance politique pour survivre ?
Les villageois partent toujours en groupe avec des caméras et essaient de protéger la personne attaquée sans contre-attaquer. Ils organisent des colloques avec des Israéliens sur des thématiques de société. C’est plus compliqué pour les soldats israéliens d’attaquer quand il y a des Israéliens. Des intervenants européens et américains viennent aussi sur le terrain. Le magazine Colette fait parler une Palestinienne qui explique qu’elle a filmé la mort de son frère. Elle s’est servie de la vidéo pour dénoncer les actes d’Israël. Breaking the silence est un mouvement de soldats vétérans israéliens qui commence à se faire entendre.
Comment accepte-t-on de vivre dans un pays qui commet quotidiennement des meurtres ?
C’est une vraie question. La société israélienne connait un problème de violence des femmes. Les hommes sont violents quand ils rentrent chez eux après leur service. Les Israéliens évitent de se poser des questions. Par exemple, à Tel-Aviv, on ne voit pas de soldats, on se sent en sécurité, on ne se pose plus de question. Même les mouvements pacifistes qui y sont implantés se disent que finalement, la vie sur place est confortable. Dans les colonies, la population s’enferme elle-même. Il y a aussi un problème global de racisme qui découle du projet colonial sioniste.
Pouvez-vous développer la question des réfugiés ?
C’est le nœud, on ne peut pas parler de la Nakba car question des réfugiés. Il n’y aura pas de retour en Israël et en Palestine pour les israéliens. Le discours de l’OLP : droit de tous les réfugiés car déclaration universelle des droits de l’homme. Droit au retour mais est prés à négocier pas en Israël a part regroupement familial car les Juifs ne seraient plus majoritaires sur le territoire israélien. Ils ne sont pas passés au stade : on est un pays démocratique, pas uniquement juif. La question des réfugiés est traitée par un comité spécifique à l’ONU. Il existe aujourd’hui 59 camps et 5 millions de palestiniens sont enregistrés comme réfugié.
La situation est-elle en train de changer ?
Les Israéliens continuent à courir après le temps car les occidentaux finiront par s’opposer à la colonisation. Ils changent la nature du terrain et essaient de faire en sorte que les Palestiniens ne puissent plus reconnaitre leur État. Silwan est en train d’être rasée (Beit Hanina aussi) afin d’y construire une sorte de « Puy du Fou ». Lorsque les Israéliens construisent le mur, ils détruisent ce qu’il y a autour pour des raisons de sécurité. Tous les deux mois, les Israéliens photographient Jérusalem et si des Palestiniens ont fait un agrandissement ou ont rajouté une brique, on leur prend leur appartement. Les colons occupent les étages d’en haut, ils harcèlent pour obtenir les autres étages. Par exemple, lorsque les enfants israéliens vont à l’école sous escorte de l’armée, les Palestiniens n’ont pas le droit de sortir.
Quel est le statut de Jérusalem avant 2004 ?
Depuis 1947, Jérusalem est une entité internationale. Cela n’est pas appliqué mais reste toujours valable. Les Israéliens parle d’un vide juridique et n‘étant pas appliqué, ce statut n’est pas valable selon eux. Il est donc illégal de reconnaitre Jérusalem comme capitale israélienne.
Le printemps arabe va-t-il contrecarrer la description d’Israël comme “la seule démocratie du Moyen-Orient” ?
La démocratie n’est appliquée que pour les Juifs. Israël est une ethnocratie et les Européens reprennent le discours israélien au lieu de regarder ce qui s’y passe vraiment. Les printemps arabes prennent du temps à se stabiliser. En réalité, les Occidentaux ne se préoccupent pas de la démocratie. Par exemple, on ne parle pas des problèmes de démocratie en Arabie Saoudite car c’est le premier acheteur d’armes des Français.