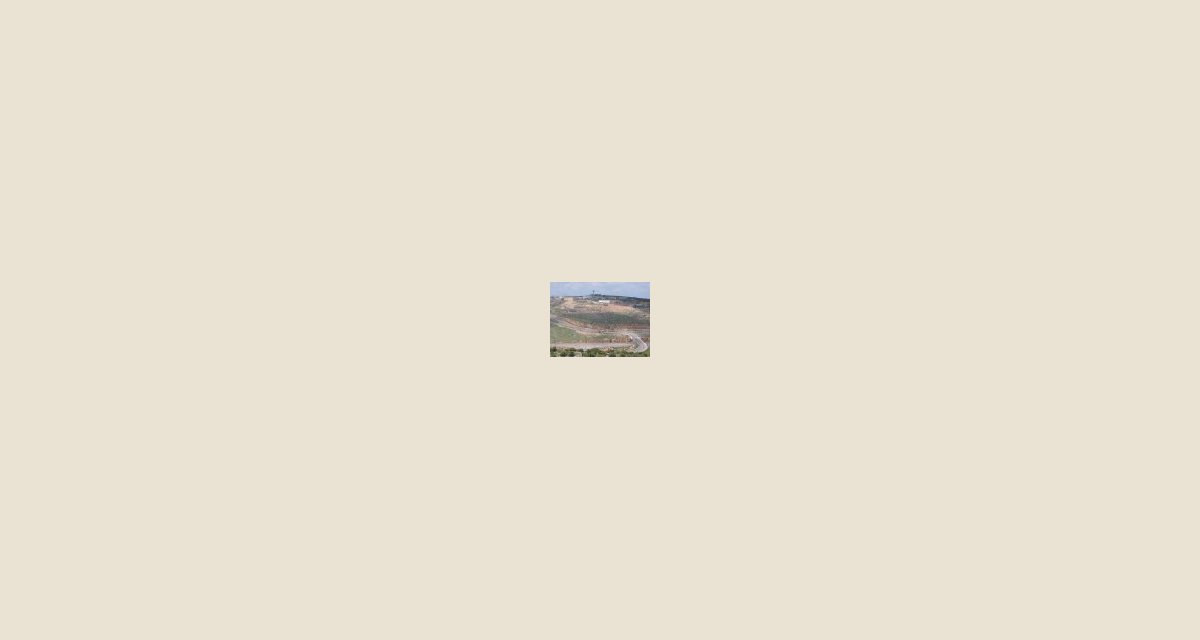En Cisjordanie, les territoires ne
sont pas seulement parsemés de
colonies de peuplement ; également
de colonies industrielles installées
pour produire à bas prix,
voire contourner la législation israélienne
en matière de protection de
l’environnement [1]. Barqan est l’un
de ces centres. Implanté à la périphérie
du vaste ensemble de la
colonie d’Ariel, il emploie des centaines
d’hommes des villages palestiniens
avoisinants.
Il fut un temps où travailler dans
ces colonies était mal perçu, considéré
comme un acte de collaboration.
C’était l’époque où les travailleurs
palestiniens pouvaient
encore se faire employer en Israël.
Ceux qui le peuvent sont rares,
alors les candidats à l’embauche se
multiplient. Mais les témoignages
sont difficiles à recueillir : la honte
demeure. Qui plus est, évoquer les
conditions de travail qui sont là bas
pratiquées comporte toujours
le risque de perdre son emploi.
« Mon nom ? Pas de problème,
vous pouvez le
noter : Ayoub Abou Hejleh.
Je suis contrôleur machine chez
Iron industries dans la colonie industrielle
de Barqan [2]. J’ai 36 ans et suis père
de cinq enfants. Beaucoup, ici, refuseront
de parler. Moi, c’est terminé. Peutêtre
est-ce parce que j’ai connu autre
chose que j’accepte moins ce qui se
passe dans cette zone où des dizaines
d’entreprises d’aluminium, de fibre de
verre, de plastique ou de matériel militaire
déversent chaque jour dans les
sols et l’atmosphère, des tas de déchets
industriels qui sont en train de nous
étouffer... Peut-être.
PLP : Que faisiez-vous avant ?
A. A-H. : J’ai longtemps travaillé dans
les Emirats comme ingénieur électronicien.
Je suis revenu en Cisjordanie en
2000 pour aider ma famille à la mort de
mon frère, au pire moment.
PLP : Au pire moment ?
A. A-H. : Au moment où Israël fermait
ses frontières à plusieurs dizaines de
milliers de salariés palestiniens. A mon
retour au village, j’ai été au chômage
quelques mois avant de trouver un poste
de technicien près de Qalqiliya. Un bon
poste que j’aurais bien gardé s’ils n’avaient
construit ce mur. Avant septembre 2003,
l’usine dans laquelle je travaillais était
en Cisjordanie. Après septembre 2003,
elle s’est retrouvée dans les territoires
« annexés » par Israël.
PLP : Et alors ?
A. A-H. : Alors ? Sans permis de travail,
plus d’emploi ! J’ai fait les démarches
pour en obtenir un, je l’attends toujours.
Très vite, un ami m’a indiqué qu’ils recherchaient
de la main d’oeuvre à Barqan.
Mais je ne voulais pas y aller. Je savais
qu’il était possible de se faire embaucher
facilement là-bas, mais je connaissais
la situation. J’ai résisté sept mois puis
j’ai fini par me laisser convaincre. Sept
mois sans salaire, sans revenu, sans
un shekel : quelle alternative avais-je ?
PLP : Comment est-on perçu lorsque,
comme Palestinien, on travaille dans
une colonie ?
A. A-H. : Avant le début de l’Intifada
alors qu’il était possible de trouver un
emploi en Israël, c’était excessivement
mal vu. Les difficultés sont telles
aujourd’hui que tout le monde sait que
l’on n’a plus le choix. Il faut bien gagner
sa vie. Lorsqu’au début de l’année 2004
j’ai commencé mes démarches pour
l’obtention d’un permis de travail pour
me rendre à Barqan, d’un coup, tout
s’est débloqué. Ce permis qui m’était
refusé depuis des mois pour gagner ma
vie dans l’usine de Qalqiliya m’a été
accordé en quatre heures pour me rendre
chaque matin dans l’une des zones les
plus polluées de Cisjordanie.
PLP : Quatre heures, vraiment...
A. A-H. : Quatre heures,
pas une de plus ! Il n’y a
pas un Israélien pour
accepter de prendre les
risques que nous prenons.
Aucun des établissements
qui sont
implantés à Barqan ne
respecte les règles de
sécurité minimales ou les
normes anti-pollution. Je
vous assure que ceux qui peuvent éviter
ces lieux les évitent. Seul le management
vient d’Israël. Les ouvriers sont
palestiniens, parfois indiens, chinois ou
russes.
PLP : Combien gagnez-vous ?
A. A-H. : Quatorze shekels de l’heure :
trois shekels de moins que le salaire
minimum reconnu en Israël pour un
manoeuvre ou une femme de ménage.
Je travaille 12 heures par jour, la demi-heure
de pause du midi et le break du
matin sont décomptés. Je ne dispose
d’aucun contrat écrit, je quitte le village
à 5h pour prendre mon poste à 6h. Je
rentre chez moi à 19h. Je ne me couche
jamais après 21h pour être sûr d’être en
bonne condition le lendemain matin tant
les conditions de production sont dangereuses.
PLP : Avec la formation que vous avez,
vous ne pourriez pas trouver autre
chose ?
A. A-H. : Bien sûr que je rêve d’une
autre vie. Qui n’en rêverait pas ! Je me
suis inscrit à l’Université ouverte de Jérusalem
[3] où je prépare un master en
management. Inch’Allah. En attendant,
je suis là. Je n’ai pas le choix. Et ce que
les usines déversent sur les terres avoisinantes,
je l’inhale tous les jours dans
l’usine : des vapeurs d’huile et de zinc.
Partout autour de la zone, les terres sont
brûlées. Sur l’un des flancs de la colline,
une étrange herbe verte pousse
depuis quelques mois, de celles qu’on
n’a jamais vues par ici auparavant.
Lorsque je me brûle, comme je me suis
déjà brûlé, lorsque j’ai mal à la tête
comme nous l’avons tous dans l’usine,
au moins, je sais, je
vois ce qu’il m’arrive.
Quand je respire l’air
qui m’entoure, je ne
me rends compte de
rien. Dans quel état
seront mes poumons
dans dix ans ? Il y a
deux ans, un salarié
a perdu son bras
dans l’atelier : broyé
par la machine sur
laquelle il était posté.
Il y a quatre jours, un
ami a reçu une pièce de 400 kilos sur son
pied. Double fracture. Iron ne connaît
pas le droit du travail, les conditions minimales
de sécurité. Il faut qu’il y ait beaucoup
d’accidents sur une machine avant
qu’ils ne se décident à agir. Le permis
que nous avons n’est valable que pour
cette usine. Alors, tu acceptes ou tu pars.
Et après ? Après, qu’est-ce que tu fais ?
Il n’y a plus d’emplois à cinquante kilomètres
à la ronde, ici. Les terres que
nous avions ont été confisquées pour
la construction des sept colonies qui
nous entourent. Celles qui nous restent
sont, en partie, impropres à la culture.
Le Wadi Qana, cette vallée où la majorité
des habitants avaient des terres est
devenue le dépotoir des colons israéliens.
Aujourd’hui, c’est Barqan ou rien :
comme tous les autres, je n’ai pas le
choix. Nous sommes des centaines à y
gagner notre vie. Aucune loi ne s’applique
là-bas. Selon la loi israélienne, les
employeurs doivent accorder aux travailleurs
de la métallurgie un litre de lait
par semaine. Il paraît que ça protège. En
avril dernier, la direction a décidé de ne
plus se plier à cette obligation et nous
a proposé en échange de nous donner
200 grammes de café. Sans doute avait-elle
décroché un lot à bas prix, lot qui a
du s’épuiser puisque, en juin, elle a
annoncé nous verser une prime de 50
shekels à la place. Et, en juillet, elle a
déclaré la supprimer.
PLP : Avez-vous des informations sur
les produits déversés par les usines de
la zone ?
A. A-H. : Non, je ne pense même pas
que les colons en aient. Pourquoi d’ailleurs
s’y intéresseraient-ils ? La terre les indiffère.
Ils la veulent, oui ! Mais ils ne la cultivent
pas. Pour avoir des informations,
il faudrait que l’Autorité puisse contrôler
ce qui s’y passe, et c’est impossible. Je
vous rappelle que la Palestine est divisée
en trois zones : les zones A sous
contrôle palestinien, les zones B où
l’Autorité gère l’administration civile et
l’armée israélienne se réserve le contrôle
du territoire. Et les zones C : 70% de la
Cisjordanie où Israël règne en maître. Barqan
est en zone C. Il n’y a donc aucun
moyen d’aller y mettre son nez. Même
si elle le voulait, l’Autorité palestinienne
elle-même ne pourrait pas y intervenir.
Pas plus que nous n’avons les moyens
de contrôler ce qui se passe autour de
la centrale nucléaire d’Amona, nous ne
pouvons savoir ce que déversent les
usines qui se trouvent à proximité. Pour
le savoir vraiment, il faudrait que nous
puissions disposer de matériels sophistiqués
pour analyser des échantillons
de terre et d’eau à proximité des usines.
Leur importation est interdite.
Propos recueillis par Martine Hassoun